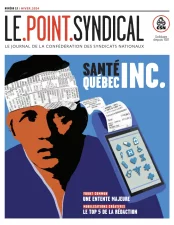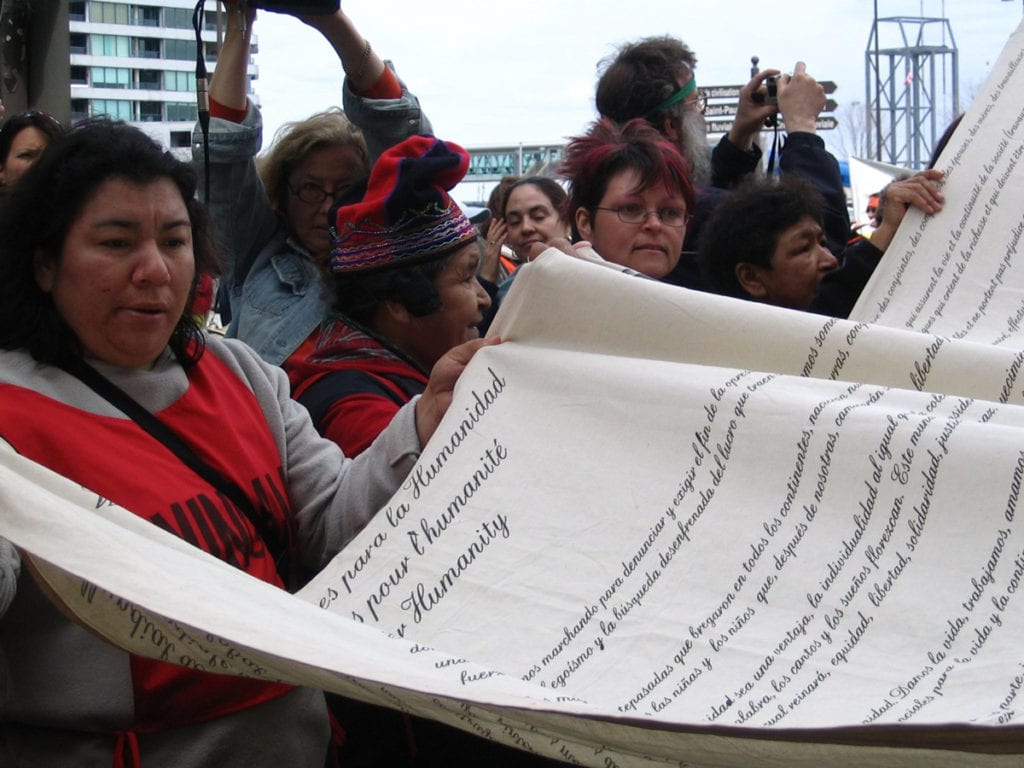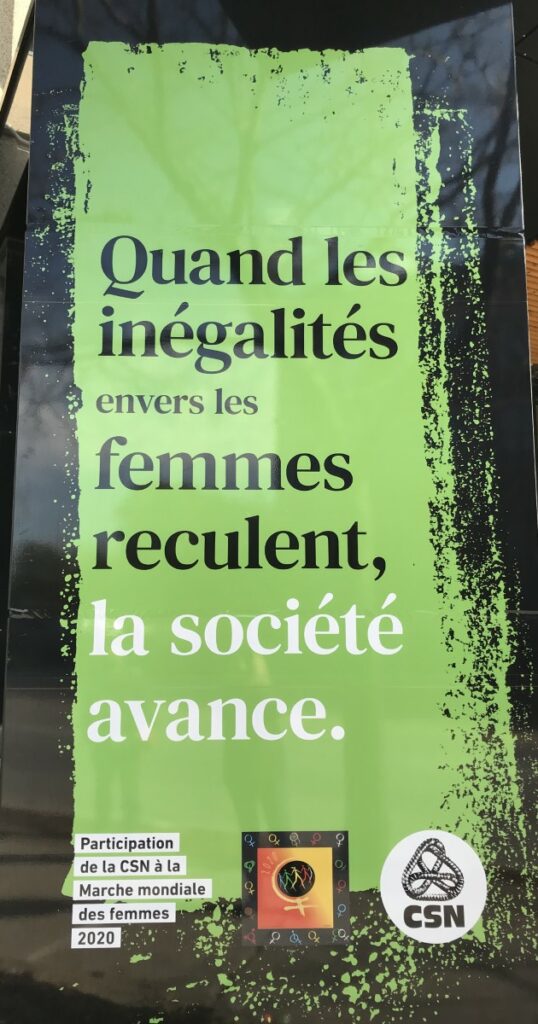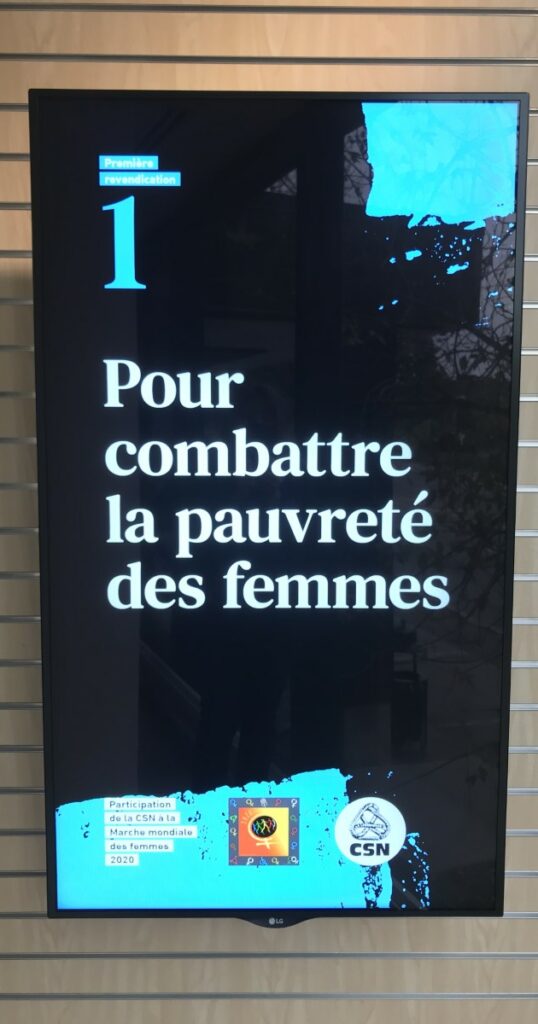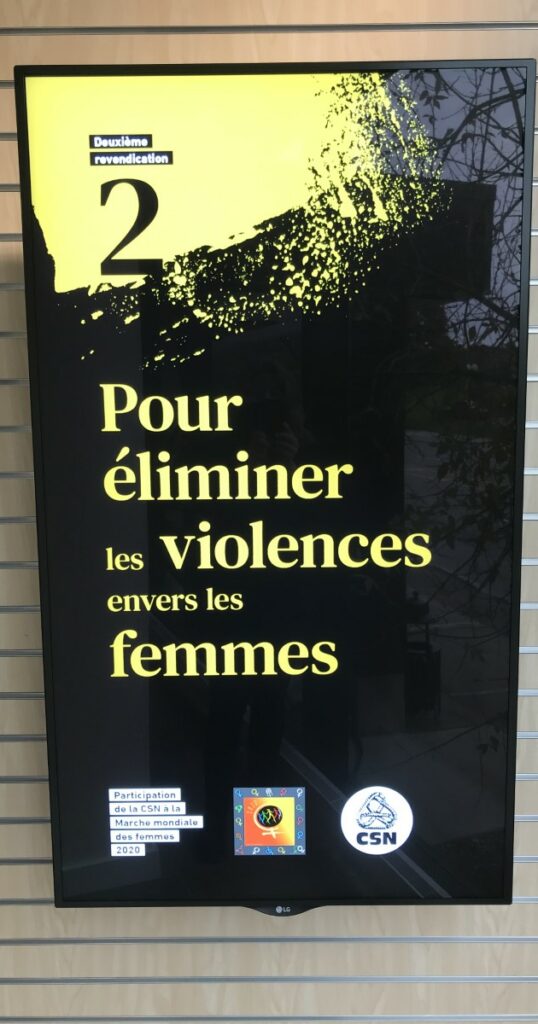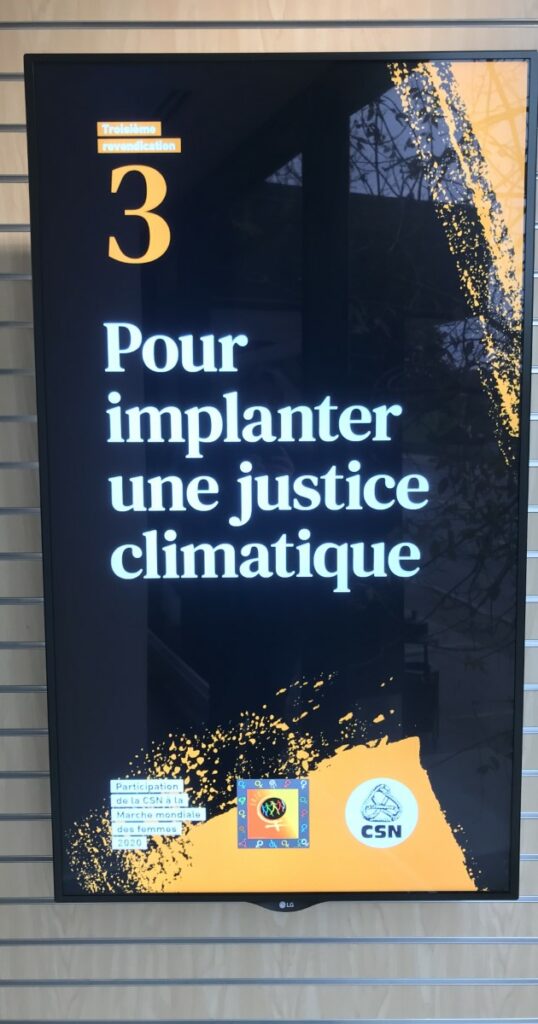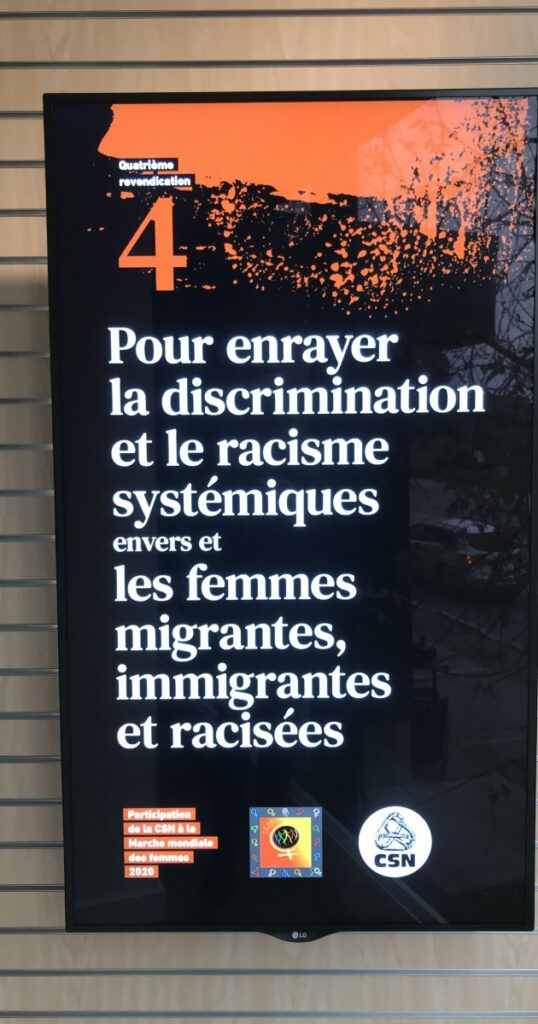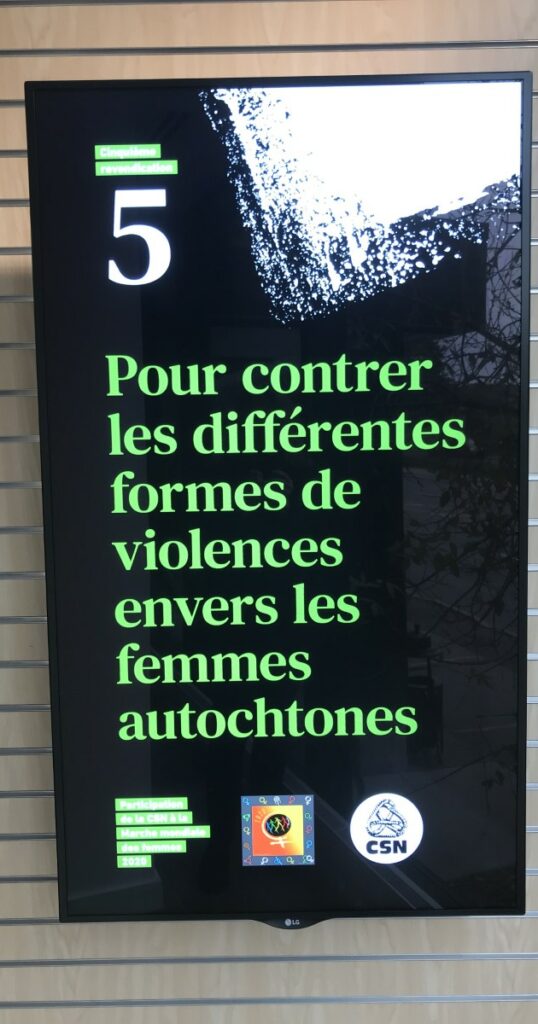- La CSN
À PROPOS
- Actualités
- Dossiers
DOSSIERS
- Campagnes
CAMPAGNES
- Formation
- Documents
DOCUMENTS
Le Point syndical
Automne 2023S’abonner, c’est possible!
Aimeriez-vous recevoir Le Point syndical à la maison? C’est possible et c’est sans frais! En savoir plus