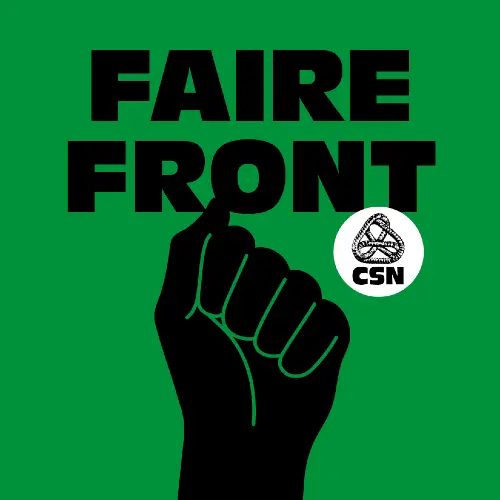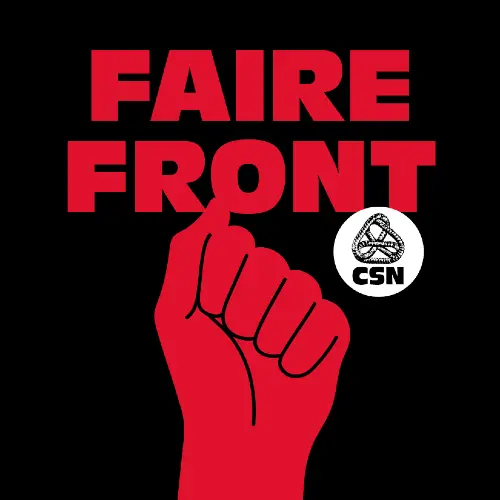Au courant de la semaine, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) a ciblé 5 problèmes prioritaires à régler d’urgence pour assurer la protection du personnel. Le gouvernement Legault tarde toujours à envoyer des directives claires pour la santé et sécurité du personnel. La FSSS–CSN continue de demander la mise en place de mesures immédiates pour appuyer le personnel, tant dans le public que dans le privé.
Les 5 problèmes identifiés par la FSSS-CSN :
- Le manque d’équipements de protection individuelle
- La protection du personnel dans les milieux de soins de longue durée (CHSLD et CHP)
- Le non-respect des règles d’isolement à domicile
- La perte de traitement du personnel en isolement
- Le dépistage du personnel
En plus de compromettre la santé et la sécurité du personnel, ces manquements entrainent des risques accrus pour la santé publique. « Chaque jour, des dizaines de travailleuses et travailleurs du réseau entrent en contact avec nous. Elles sont au front et elles sont inquiètes. On intervient sans cesse pour régler les préoccupations, mais force est de constater que le gouvernement ne fait pas tout le nécessaire pour assurer la protection du personnel. On remarque une distance importante entre le discours public du premier ministre et la réalité sur le terrain. Il faut agir vite pour éviter une éclosion de l’intérieur du réseau ! », lance Jeff Begley, président de la FSSS–CSN.
Il faut peser sur le gaz pour avoir plus d’équipements !
Plusieurs travailleuses et travailleurs du réseau s’inquiètent du manque d’équipement de protection individuelle. Pour la FSSS–CSN, les gouvernements doivent rapidement prendre les moyens d’augmenter la quantité des équipements de protection individuelle. Plus la transmission communautaire s’accentuera, plus il sera important de s’assurer d’avoir les équipements pour veiller à la protection du personnel et de la population.
Pour répondre aux préoccupations du personnel, la FSSS–CSN propose :
- Que le gouvernement transmette au personnel un échéancier du déploiement des équipements par secteur.
Stabiliser les équipes pour freiner la pandémie dans les CHSLD et les CHP
Dans les derniers jours, plusieurs éclosions sont apparues dans des CHSLD et des centres d’hébergement privés (CHP). La FSSS–CSN a remarqué certaines lacunes qui mettent à risque le personnel et les résident-es : mesures de protection insuffisantes (équipements et procédures), lenteur des communications, personnel déplacé dans plusieurs centres et sur plusieurs étages et difficulté à obtenir les équipements rapidement.
Pour régler ces problèmes, la FSSS–CSN propose :
- De stabiliser les équipes par CHSLD et CHP.
- Former des équipes de volontaires dédiées aux zones de contamination.
- Rehausser les mesures de protection applicables aux milieux d’hébergement de longue durée aux prises avec des cas de COVID au même niveau que pour les milieux de soins aigus.
« Les milieux de soins de longue durée prennent en charge des cas COVID de plus en plus lourds. Dans certains cas, on doit dédier des unités entières à ces cas. Il faut appliquer à ces milieux les mêmes mesures de protection qu’en centre hospitalier, où seraient normalement les cas COVID », souligne Judith Huot, vice-présidente de la FSSS–CSN.
Une directive insensée : ramener du monde sur le plancher avant la fin des périodes d’isolement
« Si vous revenez de l’étranger et que vous sortez de votre isolement avant la fin des 14 jours, vous pouvez vous retrouver avec une amende salée. Mais si vous travaillez dans le réseau de la santé auprès des personnes les plus vulnérables et les plus susceptibles de décéder si elles sont infectées, votre employeur peut décider de vous ramener au travail. C’est une aberration totale », lance Jeff Begley, président de la FSSS–CSN.
- Le personnel du réseau en isolement doit l’être pour toute la durée d’isolement recommandée par l’INSPQ
Maintenir le traitement pour le personnel en isolement
Certains employeurs mettent des travailleuses et travailleurs en isolement, selon les directives de l’INSPQ, sans les rémunérer. Le docteur Horacio Arruda a pourtant rappelé cette semaine que le personnel en isolement doit être rémunéré. Il faut maintenant que le gouvernement fasse le travail pour faire comprendre le message aux employeurs récalcitrants.
- Le personnel en isolement doit être rémunéré.
Tester le personnel en contact avec des cas de COVID-19
Sur la question des tests, le gouvernement indique que la priorité est pour les patient-es et le personnel. Le gouvernement indique qu’il maintient sa décision que les tests sont seulement pour le personnel présentant un symptôme. Cela pose problème puisqu’une travailleuse ayant été en contact avec une personne infectée peut l’être elle-même et être asymptomatique. C’est pourquoi il faut tester davantage le personnel du réseau.
Pour régler ce problème, la FSSS–CSN propose :
- Que l’on teste en priorité le personnel en contact avec des cas de COVID-19, qu’ils soient symptomatiques ou non.