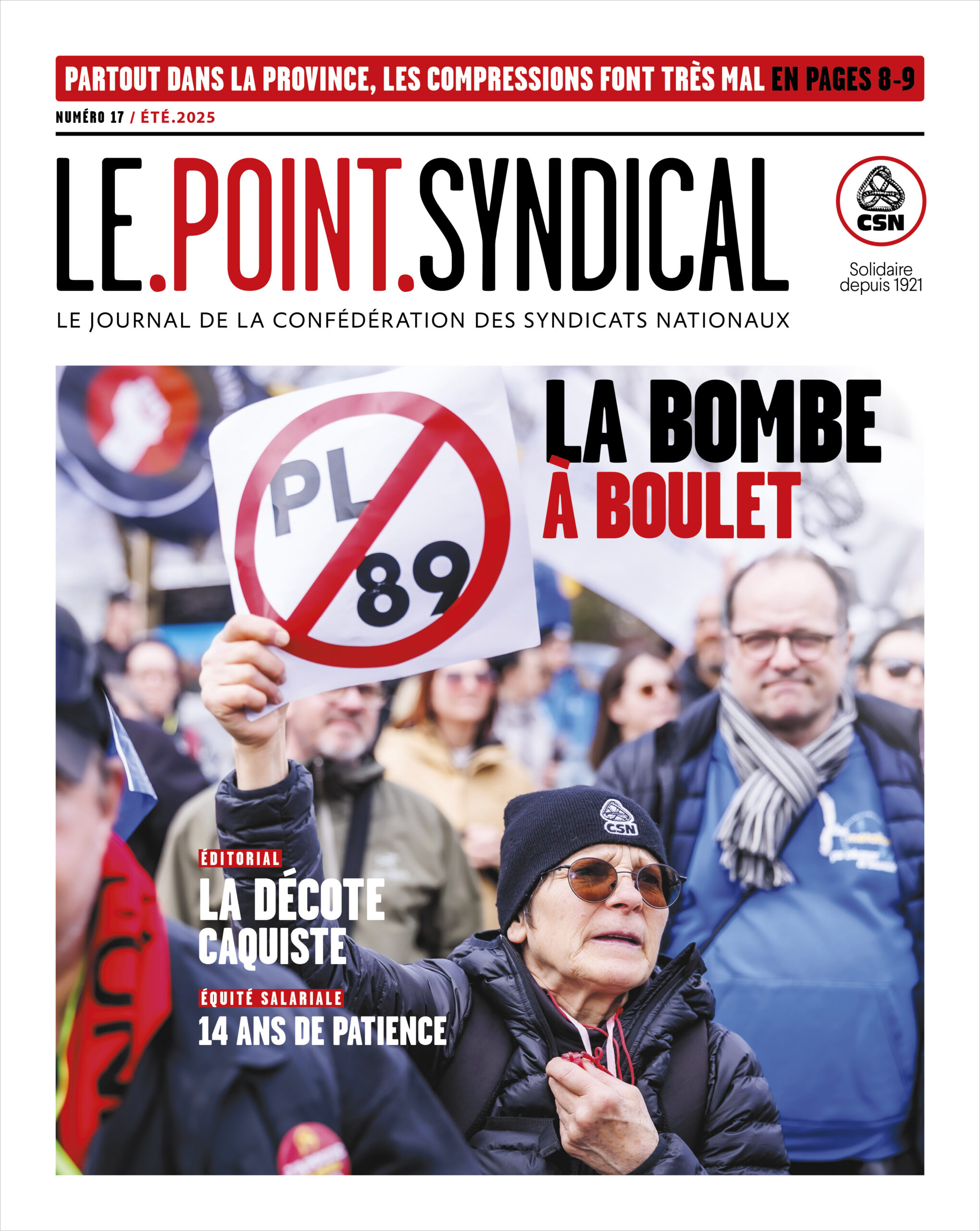Création télévisuelle
Les artisans de la télévision privée et publique réclament des politiques de financement axées sur les intérêts publics et culturels
La Fédération nationale des communications (FNC-CSN), qui représente près de 7 000 travailleuses et travailleurs dans le secteur des communications, dont celles et ceux uvrant pour la télévision privée et publique, s’insurge contre le fait de confier au secteur privé des pans toujours plus grands de la programmation des télédiffuseurs privés et publics.
Les résultats d’un sondage CROP-MCE-FNC dévoilés aujourd’hui renforcent la volonté des organisations syndicales d’obtenir une révision en profondeur des programmes gouvernementaux de financement public de la création télévisuelle.
Un sondage favorable au maintien de la télévision publique et à des priorités de financement
Le sondage révèle un attachement de la population envers la télévision publique et envers une télévision qui n’est pas gouvernée par les cotes d’écoute. Huit Québécois sur dix considèrent que le maintien du service de télévision publique est « assez » à « très important ». La grande majorité, sept personnes sur dix, déclare que c’est le rôle des gouvernements de subventionner certaines émissions et accorde la priorité aux émissions culturelles et pour enfants ainsi qu’aux documentaires, principalement diffusés dans les réseaux de télévision publique. Seules deux personnes sur dix affirment que les émissions de variété et les téléromans, particulièrement prisés par les diffuseurs, devraient aussi bénéficier de subventions.
Par ailleurs, une majorité claire de Québécois (62 %) est en désaccord avec une télévision privée financée par l’État par l’entremise de crédits parlementaires destinés aux producteurs indépendants.
Pour une programmation au service du public, sans biais économique, et pour le maintien de l’expertise des télédiffuseurs
La Fédération nationale des communications croit qu’il est indispensable de soutenir la création télévisuelle à l’aide de fonds publics, notamment pour atteindre des objectifs culturels et viser un contenu national de qualité. Elle s’interroge toutefois sur la pertinence d’un système qui favorise un quasi-monopole privé indépendant et force les télédiffuseurs à acheter les émissions des producteurs privés pour obtenir des subventions. La FNC croit que le choix de programmation est largement influencé par ces règles, ce qui ne sert pas nécessairement l’intérêt du public et le mandat des télédiffuseurs. Selon la présidente de la FNC, Chantale Larouche, « on ne peut plus cautionner un système qui, à même l’argent des contribuables, pervertit des objectifs culturels au profit des intérêts commerciaux. Le rendement, les cotes d’écoute et l’admissibilité à des subventions ne peuvent plus être les seuls critères d’une politique culturelle responsable et performante. Une révision des règles d’allocation des fonds publics dédiés à la production s’impose. Les politiques culturelles doivent se concentrer sur l’encouragement à la création en établissant un financement basé sur des objectifs de création et un traitement égal entre tous les joueurs, qu’ils soient producteurs ou télédiffuseurs. »
La FNC et la CSN estiment que les politiques élaborées pour soutenir le financement de la production ont dépossédé l’industrie de la télévision de sa capacité de maintenir une expertise en matière de création télévisuelle. Elles déplorent que les politiques de financement public du privé consistent à livrer la création à des entrepreneurs privés qui n’ont aucun compte à rendre sur leurs activités et la manière dont ils disposent des fonds publics.
L’étude de la firme MCE Conseils permet de constater que les gouvernements financent 40 % des coûts de production d’émissions et ce taux augmente à 60 % si Téléfilm Canada et le Fonds canadien de télévision participent au financement, ce qui arrive dans environ le tiers des cas. Les producteurs privés externes qui paient en moyenne 4 % des coûts de production des émissions ont connu une hausse de leurs revenus de 180 % en dix ans. Les revenus des télédiffuseurs qui assument 28,9 % des coûts des émissions n’ont enregistré qu’une hausse de 26 % pendant la même période.
Pour une saine gestion des fonds publics, la protection de l’emploi et de la souveraineté culturelle
Une industrie nationale forte de la télévision et du cinéma doit non seulement permettre aux téléspectateurs de bénéficier d’une hausse de la qualité et de la diversité des contenus proches de leur réalité culturelle, mais elle doit aussi appuyer les artisans, selon la présidente de la CSN, Claudette Carbonneau. Cette dernière déplore qu’en dix ans, les règles en vigueur aient provoqué la perte de plusieurs centaines d’emplois au Québec chez les télédiffuseurs généralistes, qu’ils soient privés ou publics. Au Canada, avec l’ensemble de la SRC, 5 300 emplois ont été perdus. À cela s’ajoutent une réduction du financement de la télévision publique et une hausse des coûts des émissions.
La FNC et la CSN réclament une saine gestion des finances publiques et du système de radiodiffusion et que le biais financier cesse d’influencer les choix de programmation. Elles craignent que le régime actuel n’engendre de graves conséquences pour la souveraineté culturelle advenant l’abolition ou une diminution marquée du financement public de la production. Les deux organisations demandent donc que les objectifs culturels et industriels à l’origine des politiques de financement soient les seuls critères d’évaluation de la performance des programmes.
Les organisations syndicales souhaitent que le mandat d’examen du Fonds canadien de télévision, confié récemment à la vérificatrice générale, permette de faire la lumière sur le fonctionnement des fonds publics de production, car elles considèrent que le régime actuel ne garantit pas, hors de tout doute, que les contribuables en ont pour leur argent.
Source : Fédération nationale des communications(FNC-CSN) – 14 avril 2005
Pour renseignements : Pierre Roger, secrétaire général de la FNC, 514 598-2132