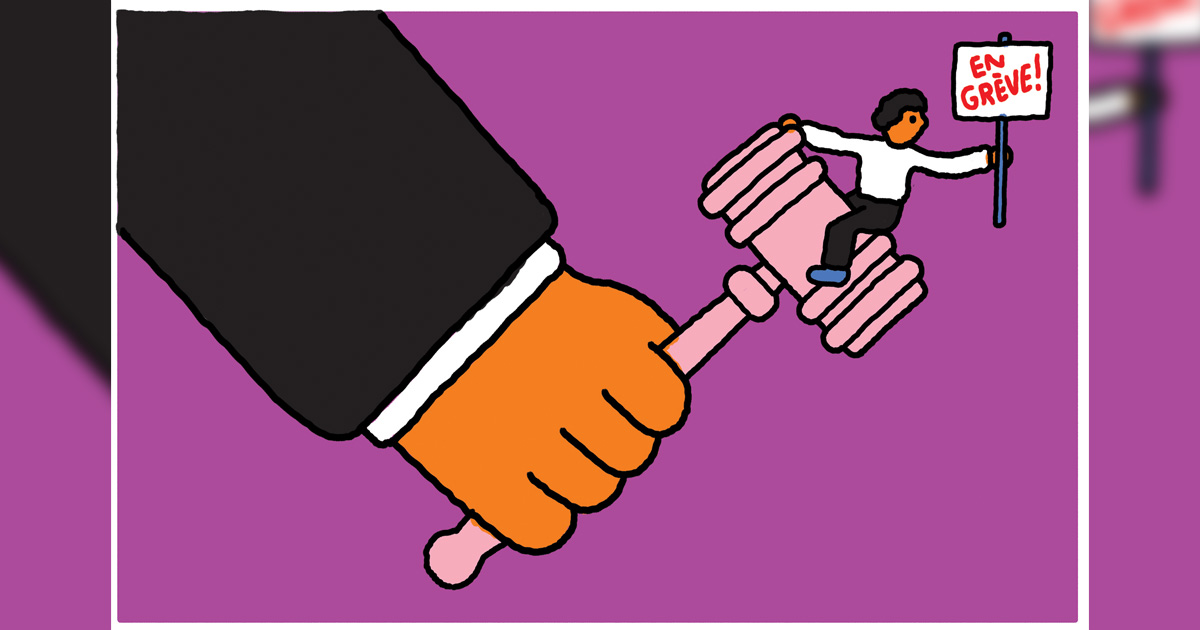Les inondations se succèdent depuis des décennies et ce sont souvent les mêmes régions qui se retrouvent sous l’eau. Que ce soit pour les taxes municipales, pour offrir des maisons à prix raisonnables ou simplement pour faire preuve de dynamisme, des villes n’hésitent pas à construire en zone inondable. Est-ce inévitable ?
Selon Danielle Pilette, professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale (UQAM) et auteure d’un très récent article sur les inondations, ce scénario pourrait très bien être évité, au moins en partie, si on prenait le recul nécessaire et qu’on mettait en œuvre les solutions qui s’imposent. Le Point syndical a rencontré cette spécialiste du monde municipal.
La première étape, c’est la cartographie des zones inondables. Ironie du sort, on annonçait en mars dernier que Gatineau obtenait 2,8 M$ pour revoir ses cartes d’ici décembre 2020. Même constat à Montréal, où la Communauté métropolitaine de Montréal dispose d’une équipe de 16 personnes qui revoit la cartographie, mais dont le travail devrait se terminer en décembre 2020.
Ces cartes devraient ensuite guider les schémas d’aménagement des villes ou des municipalités régionales de comté (MRC) afin de prévoir un zonage qui exclut le développement dans le territoire régulièrement inondable (0-20 ans). C’est d’ailleurs ce que prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Cette loi découle en partie d’une analyse des conséquences de la grande crue de 1974. Malgré ce dispositif, pourquoi n’est-ce toujours pas réglé ?
 Danielle Pilette fait d’abord remarquer que le ministère de l’Environnement a perdu l’expertise interne des risques environnementaux dont il disposait dans les années 1980. La responsabilité de l’aménagement a donc été largement décentralisée dans les municipalités et les MRC. « Les MRC misent sur des experts locaux », précise la professeure de l’UQAM, qui ajoute que ces ingénieur-es du privé vont prévoir des façons de gérer les risques géotechniques d’un nouveau site à développer. L’idée ici, c’est de ne pas être trop « rigide » et permettre le développement. Cette approche s’inscrit dans une « tendance idéologique » en place depuis la fin des années 1980 et qui consiste à reporter la responsabilité collective sur les individus. « C’est basé sur des plans et des pressions des promoteurs », résume Danielle Pilette.
Danielle Pilette fait d’abord remarquer que le ministère de l’Environnement a perdu l’expertise interne des risques environnementaux dont il disposait dans les années 1980. La responsabilité de l’aménagement a donc été largement décentralisée dans les municipalités et les MRC. « Les MRC misent sur des experts locaux », précise la professeure de l’UQAM, qui ajoute que ces ingénieur-es du privé vont prévoir des façons de gérer les risques géotechniques d’un nouveau site à développer. L’idée ici, c’est de ne pas être trop « rigide » et permettre le développement. Cette approche s’inscrit dans une « tendance idéologique » en place depuis la fin des années 1980 et qui consiste à reporter la responsabilité collective sur les individus. « C’est basé sur des plans et des pressions des promoteurs », résume Danielle Pilette.
L’accès aux maisons, au cœur du problème
Malgré la volonté de fournir un accès à la propriété à coût raisonnable pour la classe moyenne, plusieurs villes ne font pas une analyse complète de tous les coûts engendrés par l’étalement urbain, particulièrement en zone inondable.
La spécialiste en finance et fiscalité municipales de l’UQAM estime en effet que le développement de nouveaux quartiers loin des principales villes n’est habituellement pas rentable pour les municipalités. Les frais en traitement d’eau potable, en service de police et en protection contre les incendies des immeubles plus élevés, par exemple, seront bien souvent plus coûteux que le gain fiscal. Et on ne tient même pas compte d’autres factures qui seront refilées à d’autres instances (routes, écoles, transport en commun, etc.).
Nouvelle approche requise
Il faut aller vers plus de naturel, et non pas plus de digues », indique Danielle Pilette, qui fait valoir que les bassins de rétention, les milieux humides ou la « revégétalisation » des berges, par exemple, peuvent jouer un rôle pour ralentir les crues à l’échelle d’un bassin. Les digues repoussent plutôt le problème en amont. « Il y a une nouvelle cartographie des zones inondables qui s’en vient, mais est-ce qu’il y a des incitatifs pour les bassins de rétention de l’eau ? », s’interroge la professeure.
Pour Danielle Pilette, la solution est en partie politique. Un ministre des Affaires municipales plus redevable de l’impact de ses décisions, plus de préfets de MRC élus au suffrage universel, et donc moins sensibles aux pressions locales, sont deux des moyens qu’elle envisage. Selon la professeure, les ministres des Affaires municipales tentent avant tout de ne pas décevoir leurs collègues ministres.
Vers une politique nationale d’aménagement du territoire ?
« L’imperméabilisation provenant de l’étalement urbain vient limiter la capacité des sols à absorber l’eau, aggravant ainsi les impacts des inondations. D’où l’intérêt d’avoir une politique nationale d’aménagement du territoire et de l’urbanisme », affirme Sylvain Perron, coordonnateur du Mouvement Ceinture Verte, qui précise que les chercheurs ont démontré que le maintien des milieux humides en zone urbaine aurait diminué les coûts de 38 % lors des inondations de 2017.
Une vision d’ensemble contenue dans une politique nationale de l’aménagement du territoire serait requise tant pour s’attaquer aux problèmes des inondations qu’à d’autres défis liés à l’étalement urbain. C’est justement ce que propose l’Alliance Ariane, qui regroupe des centaines de signataires provenant de groupes écologiques et de professionnel-les de l’aménagement, du monde agricole et du milieu universitaire.
« Il faut se doter d’une vision cohérente pour l’ensemble du bassin versant », soutient Antoine Verville, directeur du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec et membre de l’Alliance Ariane. Ce dernier précise qu’il faut agir en amont des bassins versants en préservant les milieux naturels qui ralentissent la coulée de l’eau. Un peu plus loin dans le bassin, il faut « redonner de l’espace » aux cours d’eau pour qu’ils puissent déborder sans trop de dommages. En aval, près des villes et des exutoires, il faut retirer des habitations des zones inondables, lorsque c’est possible, et indemniser les propriétaires des maisons qui ne peuvent pas être déplacées.