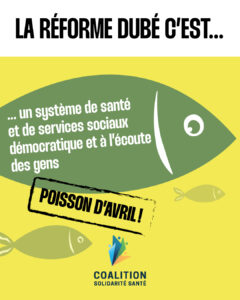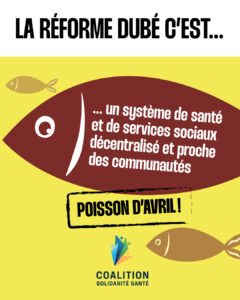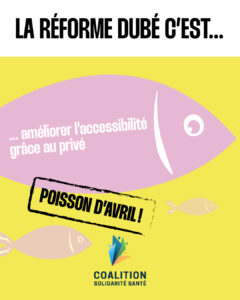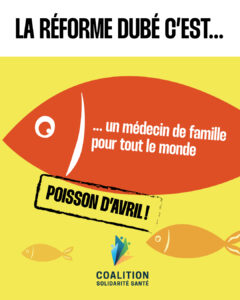Douze mois après l’entrée en force de l’agence Santé Québec comme employeur du réseau de la santé et des services sociaux, cette dernière présente un bilan catastrophique, aux antipodes des promesses faites à la population par le ministre de la Santé. La CSN, qui mène la campagne Faire front pour le Québec, réclame un réseau public de santé et de services sociaux plus décentralisé pour bien répondre aux besoins de la population.
Santé Québec et ses « top guns du privé » devaient améliorer la performance et l’efficacité du réseau, assurait Christian Dubé. Un an plus tard, force est de constater que sa réforme bureaucratique n’a eu aucun des bénéfices promis. Pire encore, l’arrivée de Santé Québec a réduit l’imputabilité du gouvernement et l’a déconnecté davantage des besoins de la population.
La liste des ratés est longue : retards de paiements de la rétroactivité et de plusieurs primes, fin du double emploi, gel d’embauches, infrastructures vieillissantes, explosion des coûts d’entretien et de rénovation, déshumanisation des soins par le recours à des applications de surveillance du personnel, surcharges de travail qui persistent, etc. Sans oublier les nombreuses erreurs et irrégularités des chantiers informatiques (Dossier santé numérique et SIFA), dignes du scandale SAAQclic.
Gestion difficile chez nous
« Dans les Laurentides, 120 postes ont été abolis et un gel d’embauche frappe la catégorie 3 ce qui amène une énorme surcharge de travail chez nos travailleuses et travailleurs. Pendant ce temps, des millions sont versés à des cliniques privées, soi-disant pour rattraper le retard. On supprime des postes, on n’embauche pas, mais on finance le privé. Je ne comprends pas comment Santé Québec prévoit être efficace et réduire les délais en investissant ainsi dans le privé. Il est ensuite facile de prétendre que le réseau public ne fonctionne pas. Santé Québec ne sert finalement que de paravent, permettant au ministre de se décharger de ses responsabilités », souligne Véronique Jean, vice-présidente du secteur santé du syndicat des travailleuse et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux–CSN.
« Sur le plancher, les travailleuses et les travailleurs manquent de tout. Plutôt que d’investir dans les soins et les services à la population, le gouvernement a choisi de consacrer des sommes considérables à une nouvelle couche de bureaucratie inefficace. C’est un véritable gâchis. On vient aussi museler les comités des usagers.
Santé Québec affaiblit le rôle de contre-pouvoir que ces comités exercent au nom des patientes et des patients. Leur mandat est pourtant essentiel : protéger les usagers, signaler les problèmes observés sur le terrain et informer la population. Leur autonomie vient d’être retirée au profit d’une gouvernance centralisée et autoritaire. » déplore Chantal Maillé, présidente du Conseil Central des Laurentides–CSN
En fait, la réforme Dubé et Santé Québec ont précipité le réseau dans une crise sans précédent. « M. Dubé se targuait de vouloir ébranler les colonnes du temple. Il l’a plutôt jeté à terre. Le réseau n’a jamais subi autant d’attaques de la part d’un gouvernement et celles-ci profitent aux entrepreneurs privés comme ceux que M. Dubé est allé recruter pour la mise sur pied de Santé Québec. Pour la CSN, il n’y a pas de profit à faire avec la maladie, c’est pourquoi on continue de faire front pour un réseau vraiment public », termine la présidente de la CSN, Caroline Senneville.
Faire front pour le Québec
La CSN mène la campagne Faire front pour le Québec pour inviter la population à se mobiliser face au bilan désastreux du gouvernement Legault. La CSN fait front pour un meilleur partage de la richesse, pour des services publics aptes à s’occuper de la population et pour une transition juste.
À propos
La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l’enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l’ensemble du Québec.
Fondé en 1969, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL–CSN) regroupe 88 syndicats et plus de 22 000 membres. Il est l’un des 13 conseils centraux de la CSN couvrant le territoire québécois.
Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s’engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.