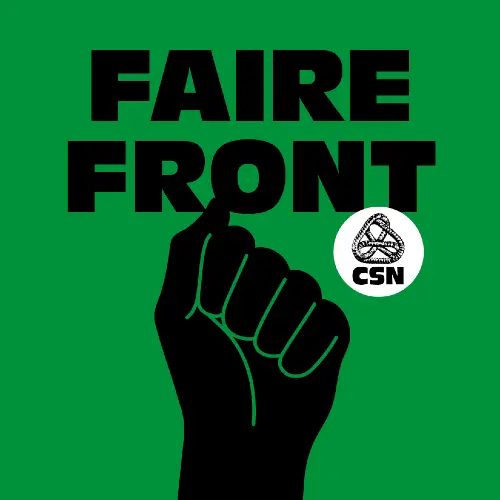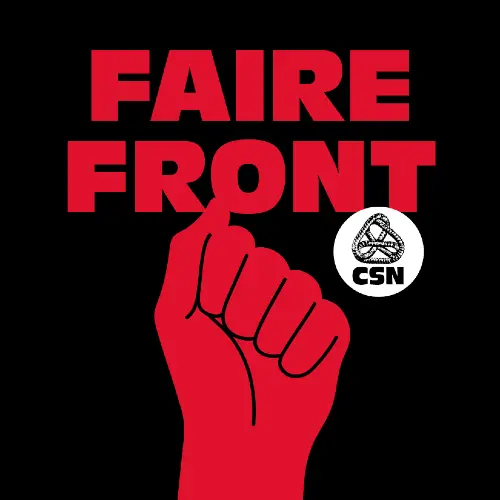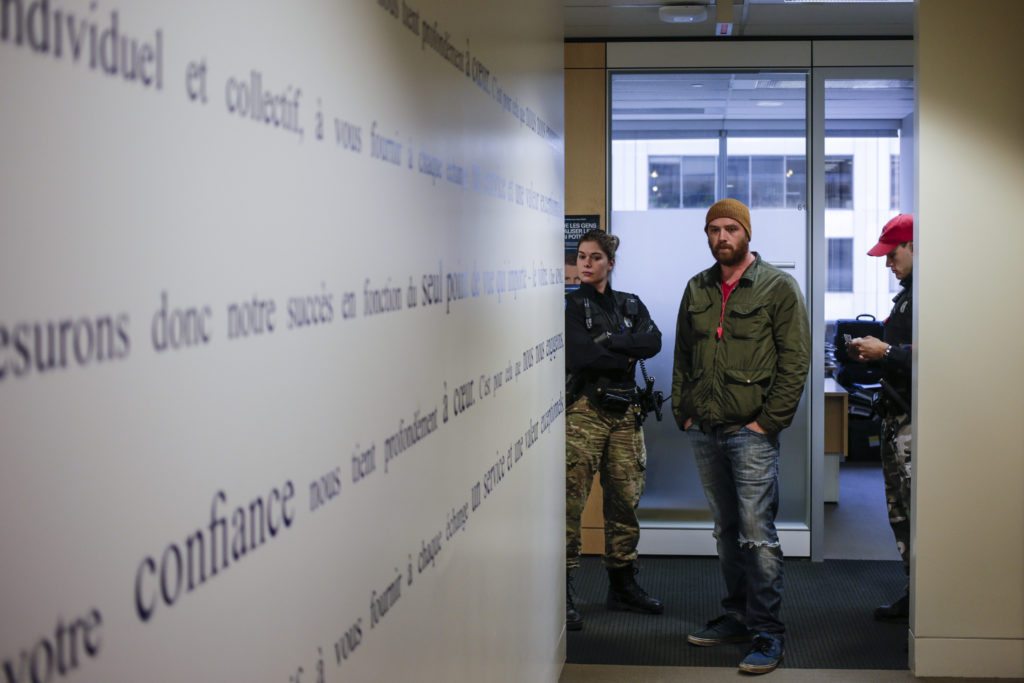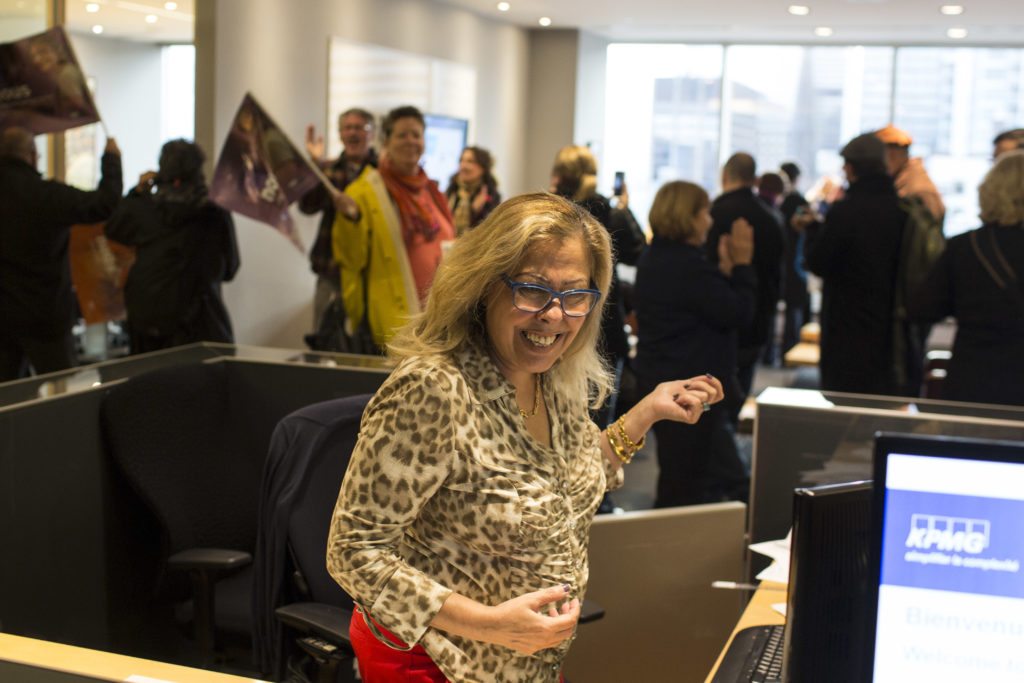Fort d’un mandat de grève de six jours, le Front commun annonce que ses premiers jours de débrayage se tiendront dans la semaine du 26 octobre si aucune avancée sérieuse n’est constatée aux différentes tables de négociation du secteur public.
« Cela fera bientôt un an que nous négocions avec le gouvernement, rappelle le président de la FTQ, Daniel Boyer. Jusqu’à ce jour, il n’a toujours pas répondu à nos préoccupations concernant le retard salarial, la précarité d’emploi, le recours au secteur privé pour la prestation de services ou encore la dégradation de l’autonomie professionnelle des salariés du secteur public. Les offres présentées par le Conseil du trésor en décembre ne sont ni plus ni moins qu’une fin de non-recevoir de nos demandes. Et tant que le gouvernement demeure sur sa position de gel salarial, il nous est impossible d’entrevoir une contre-proposition. Le gouvernement doit envoyer dès maintenant les mandats nécessaires à ses négociateurs pour que nous en arrivions à un règlement satisfaisant et négocié. »
« Notre calendrier de grève, basé sur le principe de gradation des moyens de pression, prévoit laisser tout l’espace nécessaire à la négociation, affirme Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN. Nous commencerons, si nécessaire, la semaine du 26 octobre prochain, à raison d’une journée par région. Selon la conjoncture de la négociation, si nous ne parvenons pas à une entente à l’ensemble de nos tables, nous poursuivrons la grève dès le 9 novembre, avec deux journées pour chacune des régions du Québec. Et si nous sommes toujours dans l’impasse, nous n’aurons d’autre choix que de déclencher une grève nationale les 1er, 2 et 3 décembre prochain. Nos membres sont très conscients des impacts éventuels sur la population d’un débrayage, mais l’intransigeance du gouvernement nous pousse à devoir augmenter les moyens de pression. Notre intention n’est pas de nuire à la population, mais bien d’améliorer nos conditions de travail et de garantir l’accessibilité à des services publics fortement malmenés par le gouvernement libéral. Le droit de grève est un droit constitutionnel reconnu par la Cour suprême qui s’applique également aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public. »
Ces journées de grève s’exerceront sur une base nationale dans le cas des fonctionnaires et des ouvriers de la fonction publique du Québec, ainsi que des salariés de l’Agence du revenu du Québec et de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. « La détermination des 400 000 membres du Front commun est à la hauteur de l’arrogance du gouvernement libéral, souligne la porte-parole du SISP, Lucie Martineau. M. Coiteux a vu les images de notre manifestation monstre samedi dernier rassemblant plus de 150 000 personnes, provenant de partout au Québec, qui ont déferlé dans les rues de Montréal. J’espère qu’il saisit bien l’ampleur des mandats de grève que nous avons obtenus. De toute ma vie, je n’ai jamais vu d’assemblées aussi bondées, de mandats de grève aussi forts. Notre objectif n’est pas de faire la grève. Nous avons toutefois l’obligation de mettre toute la pression nécessaire sur le gouvernement libéral afin d’en arriver à un règlement pour préserver la qualité des services publics. Évidemment, avant d’exercer notre droit de grève, nous comptons utiliser tous les moyens nécessaires. Voilà pourquoi, dès lundi prochain, des actions de perturbations socio-économiques seront menées dans l’ensemble des régions du Québec. »
Grève tournante
La grève tournante du Front commun sera faite par des enseignants, des infirmières, des professionnels, des techniciens, du personnel de soutien et administratif, des ouvriers et des fonctionnaires dans l’ensemble des établissements des réseaux de la santé et des services sociaux, des commissions scolaires, des cégeps, des organismes gouvernementaux et de la fonction publique.
En alternance, les différentes régions du Québec seront en grève aux dates suivantes : 26 octobre : Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec 27 octobre : Québec-Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, les fonctionnaires et ouvriers de la fonction publique du Québec ainsi que de l’Agence du revenu du Québec 28 octobre : Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec et Mauricie 29 octobre : Montréal, Laval et les salariés de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse 9 et 10 novembre : Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec 12 et 13 novembre : Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec, Mauricie, Québec-Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, les fonctionnaires et ouvriers de la fonction publique du Québec ainsi que de l’Agence du revenu du Québec.
16 et 17 novembre : Montréal, Laval et les salariés de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse
1er, 2 et 3 décembre : grève nationale