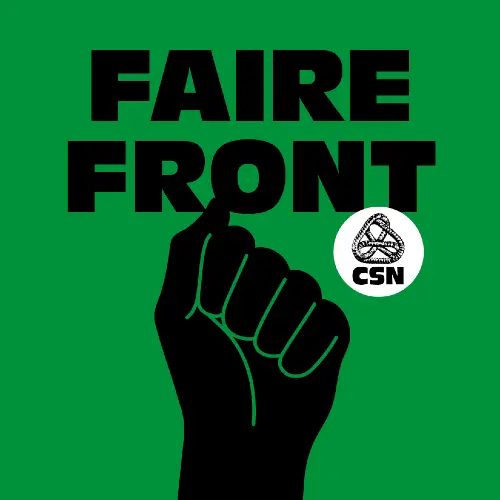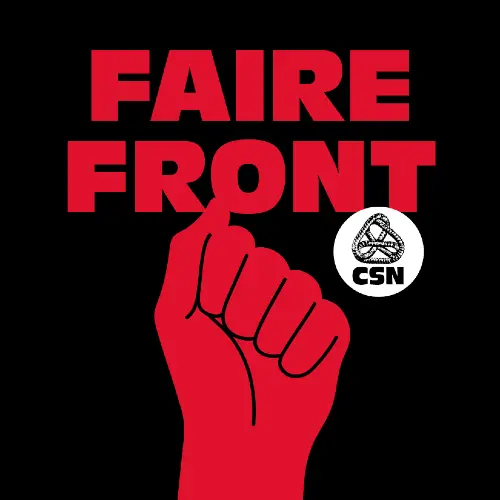En plus d’avoir mis ses employé-es en lock-out, l’entreprise Prelco a été pointée du doigt pour le recours à des briseurs de grève. Pour la CSN, la seule manière de mettre fin à ce conflit est de convenir d’une bonne convention collective.
Dans une décision du Tribunal administratif du travail rendue le 26 juillet dernier, l’entreprise spécialisée dans la fabrication de vitrages commerciaux s’est vue ordonner de cesser le recours à deux briseurs de grève. Cette ordonnance de sauvegarde vient confirmer les soupçons du syndicat sur le recours aux briseurs de grève. Sans convention collective depuis le 31 janvier 2024, les près de 90 travailleurs et travailleuses de Prelco à Montréal sont en lock-out depuis le 19 juin 2024.
« Tout ce qu’on veut, c’est le respect. On réclame des augmentations salariales qui tiennent compte de l’inflation. Nous voulons améliorer nos conditions de travail pour continuer de pratiquer notre métier longtemps. Avec son lock-out et le recours aux scabs, l’employeur ne fait rien pour trouver une solution au conflit », déplore Koffi Dramane, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de Prelco-Montréal–CSN.
« Plutôt que de jouer au hors-la-loi en utilisant des briseurs de grève, Prelco devrait se mettre au travail pour relancer la négociation », poursuit Ramatoulaye Diallo, trésorière du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN).
« Les dirigeants de Prelco doivent bien réfléchir à leurs actions. Après le conflit, il y a aura des relations de travail à maintenir. En agissant comme ils le font actuellement, ils devront travailler fort pour regagner la confiance des travailleurs et des travailleuses. L’employeur doit changer de ton rapidement parce que les salarié-es sont déterminés à se faire respecter », conclut Kevin Gagnon, président de la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM–CSN).
À propos
Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Prelco est affilié à la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM–CSN). La FIM-CSN représente plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 320 syndicats et provenant de toutes les régions du Québec.
Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s’engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.