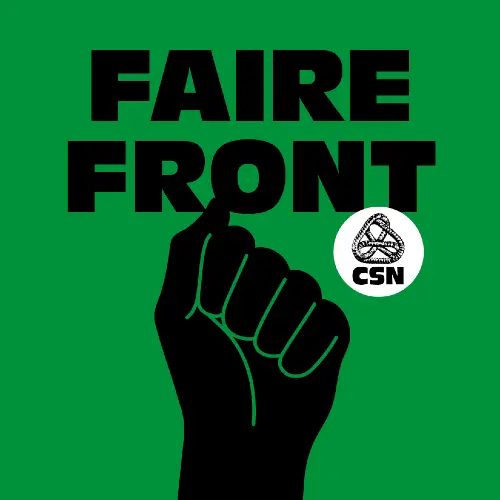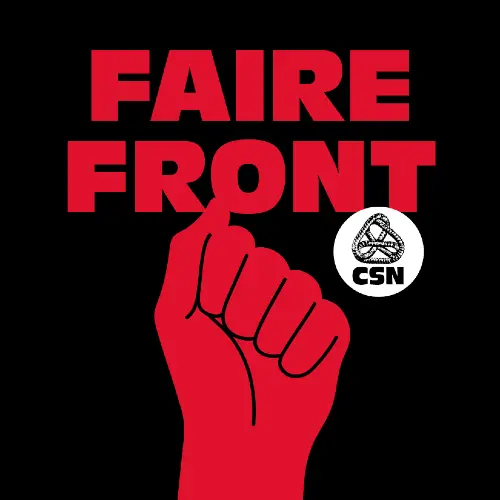Les travailleuses en centres de la petite enfance (CPE) et les responsables de service de garde éducatif en milieu familial (RSGE) affiliées à la CSN joignent leurs voix pour dénoncer l’attitude du gouvernement du Québec dans leurs deux négociations respectives. Ces travailleuses profitent de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance pour dénoncer le manque de vision du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) et réclamer de meilleures conditions de travail.
Surcharge de travail, exode des travailleuses, difficulté de recrutement, manque criant de places pour les enfants : le réseau souffre cruellement du désengagement du gouvernement. « Plutôt que d’offrir à ces travailleuses des conditions pour qu’elles demeurent dans le réseau et qui attirent la relève, ce gouvernement préfère maintenir des salaires bien en dessous de ceux versés dans le secteur public. Et pour y avoir droit, il leur demande d’accepter des reculs dans leurs conditions actuelles d’emploi », critique Lucie Longchamp, vice-présidente et responsable des secteurs parapublic et privé de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).
« Ce gouvernement nous offre des augmentations salariales de 12,7 % sur cinq ans, en échange de “flexibilité”, de reculs pour “faire plus avec moins” et “optimiser” le réseau », dénonce Chantal Racicot, représentante du secteur des RSGE de la FSSS–CSN.
Semaine de 40 heures
« Pendant que le réseau se vide de son personnel, ce gouvernement souhaite exiger toujours plus aux travailleuses, sans mesures de soutien supplémentaires », affirme la représentante du secteur des CPE de la FSSS–CSN, Stéphanie Vachon. Elle trouve inquiétante la récente sortie publique de la présidente du Conseil du trésor qui souhaite forcer la semaine de travail de 40 heures.
« Non seulement cette demande ne nous a pas été présentée à la table de négociation, mais elle témoigne de la totale déconnexion de ce gouvernement. La solution à la crise passe par une amélioration substantielle des conditions de travail, notamment de meilleurs salaires et par une charge de travail moins lourde, mais aussi par la qualité des services aux enfants. Des ratios bien balisés et respectés entre le nombre d’éducatrices et d’enfants et un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers sont essentiels. Nous dénonçons l’attitude méprisante de Mme LeBel envers les professions en CPE », poursuit Mme Vachon.
Les RSGE ont en main un mandat de moyens de pression adopté à 96 % (grève perlée équivalente à cinq jours de grève) alors que leurs collègues des CPE sont consultées jusqu’au 15 novembre pour l’adoption d’une banque de cinq jours de grève.
Pas de profits sur le dos des tout-petits
« Plutôt que d’investir dans les CPE et les milieux familiaux, qui sont sans but lucratif, pour garantir la qualité des services et des conditions décentes aux travailleuses, ce gouvernement se dépêche de créer des places à la va-vite, en favorisant les garderies privées », souligne la troisième vice-présidente de la CSN, Katia Lelièvre. En 2023-2024, 79 % des places créées l’ont été en garderie privée.
Ce gouvernement ferme ainsi les yeux sur les problèmes de qualité des services offerts par ce modèle. Au mois de mai, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, soulignait que 60 % des garderies privées ont échoué à l’évaluation de leur qualité éducative par le ministère de la Famille.
Liste d’attente
Les données du ministère indiquent que plus de 34 000 enfants sont toujours sur la liste d’attente. « Ces enfants ont droit à une place dans un service de garde éducatif sans but lucratif. Pas une place dans un système à deux vitesses dans lequel les enfants n’ont pas tous la chance de recevoir une éducation de qualité, souligne la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, Dominique Daigneault. Alors que l’importance de l’éducation à la petite enfance est clairement démontrée depuis longtemps, comment se fait-il que les spécialistes de ce domaine, majoritairement des femmes, ne soient pas mieux rémunérées? », termine Mme Daigneault.
À propos
La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) constitue l’organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, pour 12 500 travailleuses et travailleurs, et quelque 3 000 responsables de service de garde éducatif en milieu familial (RSGE).
Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s’engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.