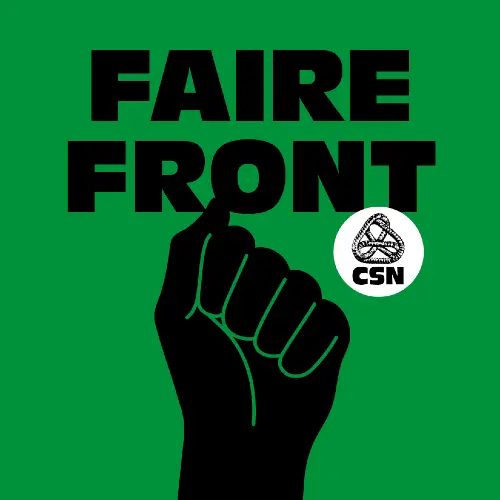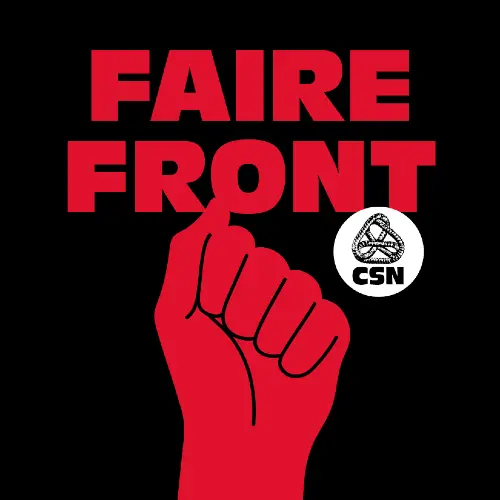PL-10 : Les mammouths
Adopté au petit matin le 6 février dernier à la suite de 15 heures de débat conclu par un bâillon, le projet de loi 10 est l’œuvre maîtresse du ministre de la Santé Gaétan Barrette. Intitulé Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, le projet de loi prévoit, entre autres, l’abolition des agences régionales et la création des nouveaux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS).
Pour le ministre, le PL-10 viendrait améliorer et simplifier l’accès aux soins et aux services grâce à l’abolition d’un palier « administratif » — les agences — et permettrait l’économie de 220 millions de dollars, sur un budget total d’environ 31 milliards de dollars. Ces compressions cadrent bien avec l’atteinte du déficit zéro, l’objectif ultime des libéraux. Selon ses prédictions, seulement 1300 cadres perdraient leur emploi au terme de l’exercice. En plus d’une diminution marquée du nombre de conseils d’administration, qui passent de 200 à une vingtaine, le projet de loi abolit la vaste majorité des CSSS.
Les critiques fusent de toutes parts. Pour la CSN, la FP-CSN et la FSSS-CSN, mais aussi pour l’ensemble des acteurs du réseau, les nouveaux CISSS et CIUSSS (centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux), rebaptisés « structures mammouths », viendront alourdir et complexifier inutilement l’organisation et l’accès aux soins et aux services. La création des CISSS et des CIUSSS aura aussi pour effet de concentrer entre les mains de quelques personnes les prises de décisions ayant un effet sur l’ensemble du réseau. Plusieurs craignent l’accélération d’une approche hospitalo- centriste, déjà dominante, où l’hôpital gobe une trop grande part du budget des nouveaux CISSS, en particulier la part dévolue aux services sociaux (notons que tous les CISSS chapeautent au moins un centre hospitalier).
Mais une des critiques les plus virulentes à l’égard du PL-10 concerne les pouvoirs démesurés que s’octroie le ministre, du jamais vu ! En effet, Gaétan Barrette se donne un droit de regard sur la composition des conseils d’administration tout en se permettant une ingérence sans retenue sur la nomination des dirigeantes et des dirigeants des différents établissements. En pleine controverse au CHUM, où le ministre veut imposer son « homme » à la tête du département de chirurgie, les allégations d’abus de pouvoir sont légion.
PL-15 : L’austérité à son sommet
Le projet de loi 15, intitulé Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, est déposé par Martin Coiteux, président du Conseil du trésor, en octobre 2014. Il est adopté deux mois plus tard, à la fin de la session. L’objectif est de contrôler la taille des effectifs des ministères, des organismes, des réseaux de la santé et de l’éducation, de même que des sociétés d’État. Les commissions scolaires, les cégeps et les composantes de l’Université du Québec, de même que la Caisse de dépôt et placement du Québec sont visés.
Le PL-15 se veut un outil législatif pour limiter de façon coercitive la croissance des effectifs de l’État, ce qui devrait permettre, selon Martin Coiteux, une économie de l’ordre d’un demi-milliard de dollars. À ce frein imposé à la croissance des effectifs s’ajoute un gel d’embauche dans le secteur public. L’austérité à son sommet, avec ses effets sur les services.
De façon unanime, les syndicats et les observateurs y voient une volonté d’augmenter le contrôle et l’emprise du gouvernement sur les sociétés d’État. En limitant sa croissance et en empêchant l’embauche, il ne fait aucun doute que le gouvernement souhaite en secret affaiblir l’État et le rôle privilégié qu’il joue au Québec depuis plus de 50 ans. Une fois les réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, mais aussi l’ensemble des sociétés d’État affaiblis, la porte s’ouvrira d’elle-même à la privatisation.
PL-20 : Des quotas, puis une entente
Déposé en novembre dernier et toujours en attente d’adoption, le projet de loi 20 avait au départ pour principal objectif d’imposer des quotas aux médecins. Pour Gaétan Barrette, l’auteur du projet de loi, le PL-10 organise les soins, alors que le PL-20 augmente les soins. À eux seuls, ces deux projets de loi viendraient, toujours selon lui, régler les problèmes du réseau de la santé. Intitulé Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée, le PL-20 dit avoir pour objectif l’amélioration de l’accès aux soins.
Au moment de son dépôt, le projet de loi imposait aux médecins de famille des quotas qu’ils devaient respecter sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération.
Mais à la fin du mois de mai, coup de théâtre. Gaétan Barrette et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) s’entendent. Les médecins de famille n’auront pas à respecter de quotas. En échange, ils doivent s’engager à ce que 85 % des Québécois et des Québécoises aient accès à un médecin de famille, d’ici le 31 décembre 2017. Si cet objectif est atteint, le PL-20 ne s’appliquera pas aux membres de la FMOQ. Le ministre de la Santé qualifie l’entente d’historique.
PL-28 : La méthode Harper
Adopté à toute vitesse sous le bâillon le 20 avril dernier, le PL-28, intitulé Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 compte rien de moins que 337 articles.
Véritable fourre-tout présenté par le ministre des Finances Carlos Leitão, cette loi touche entre autres aux tarifs des services de garde, en introduisant des hausses qui feraient grimper les frais jusqu’à 20 $ par jour pour les familles plus fortunées. Elle officialise l’abolition de deux structures municipales d’importance, les centres locaux de développement (CLD) et les conférences régionales des élus (CRÉ). Elle fixe les tarifs demandés par les pharmaciens, entraînant des baisses d’honoraires de 177 millions et fait passer de 100 millions à 500 millions de dollars par année les sommes virées au controversé Fonds des générations.
Malgré l’ampleur du projet de loi, il aura fallu seulement une dizaine d’heures de débat avant que le gouvernement de Philippe Couillard ne juge qu’il soit mûr pour l’adoption en chambre. À l’unanimité, les partis d’opposition, les syndicats et l’ensemble des observateurs ont dénoncé cette méthode trop souvent utilisée par les conservateurs de Stephen Harper. En choisissant délibérément d’inclure dans le PL-28 des politiques qui vont dans toutes les directions, les libéraux tentent de minimiser une décision majeure, celle de toucher aux tarifs des services de garde. Choix collectif ayant une incidence majeure sur la société, les services de garde voient leur accessibilité réduite de manière importante pour une première fois depuis leur création.
Privatisation insidieuse
Le projet de loi 28, tout comme le 10, le 20 et le 15 n’ont dans les faits qu’un seul réel objectif, celui d’ouvrir la porte à la privatisation et à la tarification. De manière insidieuse, en diminuant l’offre, en haussant les tarifs, en affaiblissant l’autonomie des établissements, et en dévaluant le travail des employé-es de l’État, ce gouvernement met en place les conditions idéales pour justifier la pertinence de l’entreprise privée dans les maillons de l’État social québécois.
Quelle analyse faire de ces projets de loi ?
Perspectives CSN a rencontré le vice-président de la CSN Jean Lacharité ainsi que Jeff Begley et Michel Tremblay, respectivement présidents de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).
L’histoire de deux hommes
Jean Lacharité, vice-président de la CSN
Quelle est la position de la CSN à propos des projets de loi 10, 15, 20 et 28 ?
La CSN s’oppose totalement à ces lois qui remettent en question les acquis sociaux dont s’est doté le Québec depuis la Révolution tranquille.
Qui mène au gouvernement ?
Le gouvernement libéral est l’histoire de deux hommes. Philippe Couillard et Martin Coiteux, bien que certains autres membres jouent un certain rôle, ont un certain poids. Les autres membres du gouvernement ont l’air de sous-ministres. D’ailleurs, le premier ministre laisse beaucoup de place à Martin Coiteux. On a presque l’impression qu’il se cache. Ce que ça dénote, c’est que Coiteux a l’aval complet de son premier ministre pour prendre les devants de la sorte.
Quels sont les objectifs des libéraux ?
La réponse est simple : une remise en question complète du modèle québécois tel qu’on le connaît. C’est-à-dire où l’État joue un rôle social important, même fondamental. À titre d’exemple, avec le projet de loi 10, on crée des structures mammouths. Ces dernières, accompagnées de coupes budgétaires, remettent en cause le panier de services publics.
Même chose avec le projet de loi 15 qui vise la réduction du nombre de fonctionnaires. Mais pas seulement dans la fonction publique. Les employé-es de l’État, en santé, en éducation et dans les organismes gouvernementaux, comme la CSST, sont aussi touchés. Le gouvernement prétend qu’il ne s’adresse qu’aux structures sans toucher aux services, mais c’est totalement faux !
D’où vient cette vision néolibérale et quelles en seront les conséquences ?
Le grand manitou, c’est Martin Coiteux. C’est un idéologue dogmatique de droite qui veut réduire le rôle de l’État. Ce ne sont pas seulement les fonctionnaires et autres employé-es de l’État qui vont en payer le prix, mais bel et bien tous les Québécois, toutes les Québécoises, tous les payeurs d’impôts. Que se passera-t-il quand le réseau public ne livrera plus la marchandise ? On se fera dire « faut aller vers le privé ». Car le réel objectif du gouvernement est d’ouvrir au privé. Les citoyens et les citoyennes vont devoir puiser dans leurs poches pour recevoir ces services. On nous offre des réductions minimes de taxes et d’impôts. Mais ce n’est rien comparé à ce que nous devrons payer pour nous assurer des services. Aux États-Unis par exemple, ça peut coûter entre 15 000 $ et 20 000 $ par année pour une simple assurance maladie.
Nous sommes mieux protégés en payant nos taxes et nos impôts pour nous payer les services dont on a besoin que si nous étions à la merci de l’entreprise privée, dont l’objectif est avant tout le profit.
Que propose la CSN pour combattre cette idéologie ?
Il faut d’abord et avant tout prendre conscience du dégât qu’est en train de faire le gouvernement. Ensuite, il faut nous mobiliser. Prendre la rue, être présents aux manifestations, aux rassemblements de masse. Montrer qu’on s’oppose à l’entreprise de démolition qui est en train de se profiler.
Y a-t-il une similitude entre les conservateurs et les libéraux du Québec ?
Tout à fait. Au Québec, on n’aime pas Stephen Harper et on a pu le constater lors des élections. Il faut se rendre compte que le PLQ propose une harperisation intensifiée du Québec. Le PLQ est devenu aussi conservateur que le PC à Ottawa. L’idéologie est la même, réduire considérablement le rôle de l’État. Rappelons-nous la fameuse réingénierie de l’État proposée par Jean Charest entre 2003 et 2005. Nous avions réussi à freiner ses ardeurs — même s’il y a eu certains dégâts — grâce à notre mobilisation. La CSN avait réussi. Le PLQ d’aujourd’hui tente d’achever l’œuvre de Jean Charest et de Monique Jérôme-Forget. Nous aussi nous continuerons notre œuvre : nous appelons l’ensemble des Québécois et des Québécoises à se tenir debout et à démontrer leur opposition à ce projet dévastateur.
Le sabotage des services de garde
Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux
Parmi les quatre projets de loi déposés par les libéraux, quel est le plus dommageable ?
Ils sont tous dommageables. Mais le PL 28, qui touche entre autres à la hausse des frais des services de garde, est particulièrement représentatif, car il est le parfait exemple des réelles intentions du gouvernement : ouvrir au privé en prétextant l’inefficacité des services… inefficacité qu’il a lui-même délibérément créée. Prenons les services de garde. Avant leur création en 1996, il pouvait en coûter 30 $ par jour pour envoyer son enfant à la garderie. Ces dernières avaient de hauts taux d’inoccupation. Les cégeps songeaient à réduire leur formation en la matière. Lentement, mais sûrement, les gens se sont mobilisés ; les parents, mais aussi la communauté. Devant l’immense pression populaire, Pauline Marois a créé les centres de la petite enfance (CPE). Sans mobilisation, elle n’aurait rien fait. Rapidement, la demande a explosé. Les services de garde ont reçu un appui populaire impressionnant, les gens étaient emballés. Les CPE ont eu comme impact de pousser les femmes vers le marché du travail. Celles qui y étaient déjà n’avaient plus à travailler la moitié de leur journée pour payer la garderie. C’était accessible et socialement payant. Mais la suite des choses s’est avérée vraiment décevante.
Comment les choses ont-elles évolué ?
Pendant les 20 ans qui ont suivi la création des CPE, l’offre mise de l’avant par les gouvernements successifs n’a jamais réussi à répondre à la demande. Les listes d’attente sont devenues de plus en plus longues. Puis, en 2003, on a mis fin à l’augmentation de l’offre. C’est ce que j’appelle une opération de sabotage. Il faut préciser qu’en même temps qu’on laisse stagner les places intentionnellement, les effets du Régime québécois d’assurance parentale se sont fait sentir : on assiste à une augmentation significative du nombre de naissances au Québec. Le manque de places a eu pour effet de créer de la grogne chez les gens. Le réseau est alors devenu dans la tête de plusieurs mécontents, inefficace. Les perceptions ont changé, et c’était ce que voulaient les libéraux. Il faut dire que depuis le début, le PLQ était contre le programme universel de service de garde.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Aujourd’hui, devant la supposée inefficacité du réseau des services de garde, les libéraux nous disent qu’ils n’ont pas d’argent pour le financer. Pourtant, on sait que pour chaque dollar investi, c’est 1,50 $ qui revient au gouvernement. Il faut dire que les CPE permettent à plus de femmes de travailler, c’est donc plus de gens qui paient de l’impôt. Ça, c’est pour les bénéfices économiques. Mais il y a aussi des bénéfices sociaux non négligeables. Les enfants qui fréquentent les services de garde sont encadrés, stimulés rapidement, ils socialisent, etc.
Nous ne devons pas laisser faire les libéraux. Car sinon, on va payer cher. Très cher. L’augmentation des coûts pour les familles va dépasser cent fois le remboursement d’impôt qu’on nous promet. Il faut appuyer les membres qui sortent dans la rue. Mais il faut aussi que les gens « ordinaires », qui n’utilisent pas nécessairement les services de garde, sortent pour appuyer la cause. Comme en 2012.
L’illogique PL 10
Michel Tremblay, président de la Fédération des professionnèles
Quels sont les effets concrets des projets de loi des libéraux en santé, particulièrement les 10 et 15 ?
Prenons le PL 15 pour commencer. Depuis son adoption, il n’y a plus d’affichage de postes possible, à moins d’avoir la permission directe du Conseil du trésor, dirigé de main de fer par Martin Coiteux. C’est exactement le genre de contrôle que Monique Jérôme-Forget souhaitait du temps qu’elle en était la présidente. Dans ce contexte, disons… contraignant, la loi 10 entre aussi en vigueur. Il faut savoir que le projet de loi a été écrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette lui-même, et sa garde rapprochée. Approche plutôt rare, puisque les fonctionnaires sont souvent mis à contribution dans ce genre de mandat.
La loi 10 est en fait une étape importante dans la transformation que souhaite imposer le ministre Barrette au réseau de la santé et des services sociaux. Dans la tête du ministre, d’ici cinq ans, les effectifs du réseau seront largement réduits et, parallèlement, le financement des activités médicales en fonction des actes posés sera augmenté. Pour arriver à cette fin, on réduit de 30 % le budget dédié à la santé, ce qui ouvrira obligatoirement la porte au privé.
Quel sera l’impact de l’abolition des agences de santé et de services sociaux ?
Au 31 mars dernier, 15 % du personnel d’agence ont perdu leur poste à cause du de la loi 10. Cette décision a créé toutes sortes de situations aberrantes. Prenons l’agence de Montréal par exemple. Le 1er avril, quatre postes d’agents de planification, de programmation et de recherche (APPR) ont été transférés au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. Les APPR possèdent une spécialisation en santé publique et détiennent souvent un doctorat en la matière. Rien à voir avec les services offerts au CHU Sainte-Justine, où il n’y avait pas d’APPR parce qu’il n’en avait pas besoin. La direction de Sainte-Justine, qui doit accueillir ces professionnel-les en raison de leur ancienneté, devra probablement les garder à ne rien faire… et, du même coup, comme le transfert n’est pas accompagné de budget, elle devra vraisemblablement mettre quatre personnes à pied, des psychologues qui travaillaient déjà auprès d’enfants, par exemple. Ici, on est perdant sur toute la ligne : quatre psychologues ne donnent plus de services aux patients de Sainte-Justine, et quatre APPR ne peuvent plus mettre leur expérience à contribution et travailler en prévention.
Quel sera l’impact sur la vie syndicale de toutes ces fusions d’établissements ?
C’est certain qu’avec sa loi 10, le gouvernement souhaite aussi complexifier le fonctionnement de la vie syndicale. Ce n’est pas l’objectif premier, mais disons que ça ne déplaît pas au gouvernement.
Un mot sur le PL 28 ?
C’est un projet de loi aberrant. Le cas des conférences régionales des élus, les fameux CRÉ, en est un bel exemple. Au moment de son dépôt, le PL 28 venait abolir les CRÉ, tout en empêchant les travailleurs d’avoir recours à l’article 45 du Code du travail, qui prévoit que le changement d’employeur par vente ou concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide pas l’accréditation syndicale et, s’il en existe une, la convention collective. Donc, pas de transfert possible pour ces travailleurs, puisque leur accréditation ne tient plus. Il y a finalement eu un amendement à la dernière minute. Alors qu’on espérait un assouplissement du ministre, il a plutôt opté pour la ligne dure et décidé d’étendre la mesure aux employé-es des centres locaux de développement, les CLD, et aux corporations de développement économique communautaire, les CDEC.