Nous sommes le 4 mars 2020. Les responsables des équipes de travail chargés de la préparation du 66e Congrès de la CSN en sont à leur quatrième rencontre avant l’ouverture de cette instance historique qui doit lancer les célébrations du 100e anniversaire de l’organisation. Le début du congrès est alors prévu pour le 25 mai. On sent la fébrilité dans l’air, avec la part de stress que l’organisation d’un tel rassemblement implique. Puis, à peine huit jours plus tard, le gouvernement de François Legault annonce les premières mesures de confinement en lien avec la pandémie de COVID-19 qui allait mener, quelques semaines plus tard, à la mise sur pause du Québec en entier.
Pour Jean Lortie, secrétaire général de la CSN, c’est la catastrophe : « Tout le temps et les efforts que nous avions investis jusqu’ici pour préparer ce congrès historique venaient de tomber à l’eau, le temps d’une conférence de presse. Réservations de salles, préparation des contenus, impression des documents, communications avec les délégué-es, logistique, technique, etc. : tout venait de s’effondrer en l’espace de quelques minutes à peine. » Pour celui qui en est à l’organisation de son troisième congrès de la CSN, c’est tout un choc. « Personne n’avait vu venir ce coup-là. Il fallait se revirer de bord très rapidement. C’était un véritable saut dans l’inconnu. »
Peu de temps après cette fameuse annonce du 12 mars 2020, le bureau confédéral confiait un mandat au comité exécutif de la CSN pour reporter le congrès à une date ultérieure, en rejetant l’idée de l’annuler complètement. Toutes les options ont alors été évaluées : tenir un congrès en présentiel à l’automne, opter pour un format exclusivement virtuel, imaginer une formule hybride, etc. Mais au rythme où évoluaient les choses, il était difficile de se faire une idée claire et d’arrêter une décision finale.
S’adapter constamment
Naviguant en terrain inconnu au beau milieu d’une crise sanitaire planétaire sans précédent, l’équipe responsable de préparer le congrès devait s’adapter constamment à l’évolution de la situation au Québec. « Il fallait tenir compte des décrets ministériels qui s’accumulaient et qui changeaient de semaine en semaine. C’était un véritable casse-tête, considérant tout ce que nous devions revoir et les impacts financiers et logistiques qu’un tel revirement engendrait », nous confie Marie Claude Hachey, responsable de la logistique du 66e congrès.
Dans l’espoir d’un retour rapide à la normale, la possibilité de tenir un congrès à l’automne en présence demeurait encore malgré tout sur la table. Mais dès la fin du mois d’août, voyant qu’une deuxième vague de COVID-19 se profilait à l’horizon, le comité exécutif a finalement tranché en faveur de la tenue d’un congrès exclusivement virtuel dans la semaine du 18 janvier 2021. Le bureau confédéral lui a alors donné le mandat d’établir des paramètres de fonctionnement pour l’organisation et la tenue des instances démocratiques de la CSN en mode virtuel.
Un imposant mémoire préparé par le secrétaire général et son équipe a ensuite été déposé lors d’un bureau confédéral extraordinaire en octobre 2020, expliquant toutes les modalités de la tenue du congrès en mode virtuel : le programme, l’interprétation des statuts et règlements, le mode de délibération, les procédures de vote, etc. « Il ne s’agissait pas de tout changer la marche à suivre, mais bien de l’adapter à la nouvelle réalité », explique Jean Lortie.
Les défis et les contraintes d’un congrès virtuel
Il va sans dire, l’organisation d’un premier congrès en format exclusivement virtuel pose des défis considérables, notamment en matière de sécurité et de protection de la vie privée, mais aussi sur le plan de la littératie numérique. « Comme c’était une première en mode virtuel, nous ne savions pas comment allaient réagir nos membres. Vont-ils accepter ce nouveau pacte que nous faisons avec eux par cette nouvelle formule ? » se questionne le secrétaire général.
Conséquemment, plusieurs tutoriels ont été développés pour aiguiller tant les délégué-es officiels que les salarié-es dans l’utilisation des nouvelles plateformes numériques qui allaient être utilisées pour la tenue du congrès. Mais là encore, il y avait un enjeu d’accessibilité, tant au niveau de la connexion Internet que sur le plan des équipements informatiques. Afin de limiter la consommation de la bande passante pour les participantes et participants au congrès, il a été décidé de circonscrire les plages horaires du congrès à deux blocs de 2 h par jour qui se dérouleraient sur la plateforme Digicast développée par une entreprise 100 % québécoise qui répondait à tous les critères.
Les défis étaient également nombreux sur le plan des contenus. « Malgré le fait que les thématiques initialement retenues entourant les transformations du travail étaient toujours d’actualité, le contexte de pandémie mondiale nous a vite rattrapés. Avec les impacts importants que cette crise a engendrés dans nos milieux de travail et dans notre quotidien, nous devions revoir nos priorités et retourner sur le terrain pour prendre le pouls de nos membres », explique Josée Lamoureux, responsable du contenu du 66e congrès.
C’est ainsi qu’une tournée régionale virtuelle a été organisée aux mois d’octobre et novembre auprès de l’ensemble des syndicats de la CSN. Le constat flagrant qui en est ressorti est le suivant : les gens étaient débordés par la gestion des contraintes de la pandémie. Il a donc fallu rapidement ajuster le contenu du congrès en fonction des préoccupations des membres. « Mais le plus grand défi demeurait de réconcilier une forme minimale de débat et de prise de parole avec le format virtuel et la distance physique, ce qui a été fait grâce à l’organisation d’ateliers via la plateforme Zoom », poursuit Josée Lamoureux.
Enfin, d’un point de vue logistique, là aussi, l’adaptation était de mise. « Par le passé, presque tout passait par le papier : les inscriptions, les invitations, les convocations, les lettres de créance, et j’en passe. Aujourd’hui, tout se fait de façon numérique, par courriel, ce qui impliquait un changement considérable dans nos manières de procéder », ajoute Marie Claude Hachey. Ses deux plus grands défis : l’inscription en ligne, plus spécifiquement l’obtention des adresses courriel uniques des délégué-es pour l’obtention des accès au vote électronique, ainsi que le choix de la plateforme virtuelle pour opérer un congrès avec assemblées délibérantes et un droit de vote distinct, ce que permettait Digicast.
« Nous avons dû nous adjoindre les services techniques de deux autres compagnies québécoises afin de dynamiser ce congrès virtuel. Luc Bessette, qui pilote la technique avec brio, a réussi à trouver les meilleurs de l’industrie », ajoute Jean Lortie, en référant à Solotech et à Lambert Distributions, qui ont contribué à la mise en scène, à l’éclairage et à tout ce qui touche à la technique dans ce qu’on a appelé « le studio du congrès », et à Mathieu Bessette, intégrateur vidéo et opérateur Watch Out, qui a contribué notamment à la projection d’images et de vidéos sur les murs intérieurs de la CSN.
En somme, c’est tout un défi qu’ont relevé les équipes responsables de concocter cette toute première édition d’un congrès virtuel. Mais malgré l’excellence du résultat dans les circonstances, toutes et tous s’accordent pour dire que rien ne remplace le contact humain propre au mouvement syndical. « Vous savez, ce sentiment qu’on ressent quand on entre dans une salle bondée, avec plus de 2000 délégué-es… On sent qu’on fait partie de quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Donc c’est certain qu’avec le format virtuel, il y a une part de deuil que l’on vit, mais il faut se dire que c’est pour mieux se retrouver en personne, et ce, le plus tôt possible ! », conclut Jean Lortie.










 « Pour mon premier congrès de la CSN, je suis vraiment content de briser l’isolement que la pandémie nous fait vivre actuellement. Ça relativise les expériences que nous connaissons dans nos milieux de travail. Pour moi, au départ, les instances de la CSN, c’était un peu théorique. En participant au congrès, nous partageons des expériences qui nous inspirent et nous font réfléchir. Durant les ateliers, j’ai entendu le témoignage d’un délégué qui parlait du retrait préventif des femmes enceintes dans le milieu de la santé et je l’ai contacté personnellement afin d’échanger avec lui sur les stratégies qu’ils ont déployées dans leur milieu de travail. »
« Pour mon premier congrès de la CSN, je suis vraiment content de briser l’isolement que la pandémie nous fait vivre actuellement. Ça relativise les expériences que nous connaissons dans nos milieux de travail. Pour moi, au départ, les instances de la CSN, c’était un peu théorique. En participant au congrès, nous partageons des expériences qui nous inspirent et nous font réfléchir. Durant les ateliers, j’ai entendu le témoignage d’un délégué qui parlait du retrait préventif des femmes enceintes dans le milieu de la santé et je l’ai contacté personnellement afin d’échanger avec lui sur les stratégies qu’ils ont déployées dans leur milieu de travail. »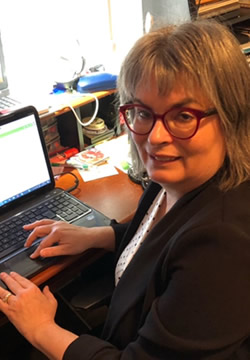 « J’aime bien ça. C’est hyper bien organisé et structuré. C’est certain que nous étions habitués à ce genre d’échanges virtuels, car depuis des mois nous travaillons et nous poursuivons notre enseignement à distance. Ça facilite l’appréciation. Bien sûr, les contacts informels, les relations intersyndicales sont inexistantes et on ne peut pas fraterniser comme avant. Il s’agit là du plus grand désavantage. Je remarque toutefois que certains participants sont plus à l’aise de prendre la parole de cette façon et c’est une amélioration notable. Je pense que pour les futurs congrès, il faudra penser à une option combinant les deux formules. La CSN n’aura pas d’autre choix que de s’adapter. »
« J’aime bien ça. C’est hyper bien organisé et structuré. C’est certain que nous étions habitués à ce genre d’échanges virtuels, car depuis des mois nous travaillons et nous poursuivons notre enseignement à distance. Ça facilite l’appréciation. Bien sûr, les contacts informels, les relations intersyndicales sont inexistantes et on ne peut pas fraterniser comme avant. Il s’agit là du plus grand désavantage. Je remarque toutefois que certains participants sont plus à l’aise de prendre la parole de cette façon et c’est une amélioration notable. Je pense que pour les futurs congrès, il faudra penser à une option combinant les deux formules. La CSN n’aura pas d’autre choix que de s’adapter. »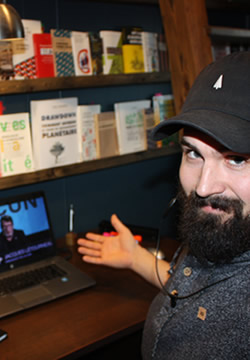 « C’est la toute première fois que je participe à un congrès de la CSN. Je n’ai pas l’expérience du présentiel, mais je trouve ça très intéressant. Ça fait du bien de sortir de notre bulle et d’entendre les autres membres de la CSN, de constater la camaraderie. Ça développe vraiment le sentiment d’appartenance. Constater l’ensemble des luttes me motive dans mon rôle de président. Je suis le seul délégué officiel de mon syndicat et ce sera important de transmettre ce que j’ai vu et entendu à mes camarades collègues, de partager avec eux la fierté ressentie. C’est certain que j’aimerais que le prochain congrès soit en présentiel afin de vivre plus humainement ce genre d’expérience, pour rencontrer d’autres membres de syndicats et échanger avec eux. »
« C’est la toute première fois que je participe à un congrès de la CSN. Je n’ai pas l’expérience du présentiel, mais je trouve ça très intéressant. Ça fait du bien de sortir de notre bulle et d’entendre les autres membres de la CSN, de constater la camaraderie. Ça développe vraiment le sentiment d’appartenance. Constater l’ensemble des luttes me motive dans mon rôle de président. Je suis le seul délégué officiel de mon syndicat et ce sera important de transmettre ce que j’ai vu et entendu à mes camarades collègues, de partager avec eux la fierté ressentie. C’est certain que j’aimerais que le prochain congrès soit en présentiel afin de vivre plus humainement ce genre d’expérience, pour rencontrer d’autres membres de syndicats et échanger avec eux. » « Mon syndicat a tenu son assemblée de fondation le 1er mars 2020, qui fut notre seule activité en présence, les autres ayant toutes eu lieu en visioconférence. Cela dit, pour moi qui ai tout à apprendre du fonctionnement de la CSN, je trouve la facture de ce congrès bien utile et d’une certaine façon, pédagogique. Je suis heureux d’assister à ce moment important pour le grand mouvement auquel nous avons adhéré il y a de cela presque un an. Compte tenu de la nature du travail archéologique (travail semi-saisonnier, mandats qui peuvent être très courts, de quelques jours seulement, etc.), je vois également d’un très bon œil les changements qui ont été apportés au Fonds de défense professionnelle. »
« Mon syndicat a tenu son assemblée de fondation le 1er mars 2020, qui fut notre seule activité en présence, les autres ayant toutes eu lieu en visioconférence. Cela dit, pour moi qui ai tout à apprendre du fonctionnement de la CSN, je trouve la facture de ce congrès bien utile et d’une certaine façon, pédagogique. Je suis heureux d’assister à ce moment important pour le grand mouvement auquel nous avons adhéré il y a de cela presque un an. Compte tenu de la nature du travail archéologique (travail semi-saisonnier, mandats qui peuvent être très courts, de quelques jours seulement, etc.), je vois également d’un très bon œil les changements qui ont été apportés au Fonds de défense professionnelle. » « Ce congrès est vraiment intéressant. Les enjeux qui y sont discutés, notamment ceux concernant le télétravail, la santé-sécurité, la vie syndicale, sont très factuels et interpellent directement les membres, que ce soit ceux qui proviennent d’un petit syndicat ou d’un plus gros. L’événement est techniquement très réussi et visuellement joli ; nous sommes bien servis par l’habillage et par les instruments technologiques qui sont utilisés, notamment les écrans de projection pour le discours de Jacques Létourneau. Je suis très heureuse de ce constat, car selon moi, la CSN a besoin de moderniser ses façons de faire et d’accompagner ses membres dans l’utilisation d’outils technologiques qui vont leur permettre d’alléger certains processus, comme la tenue d’assemblées générales. Ce congrès témoigne de la capacité de la CSN à s’engager dans cette voie, bravo. »
« Ce congrès est vraiment intéressant. Les enjeux qui y sont discutés, notamment ceux concernant le télétravail, la santé-sécurité, la vie syndicale, sont très factuels et interpellent directement les membres, que ce soit ceux qui proviennent d’un petit syndicat ou d’un plus gros. L’événement est techniquement très réussi et visuellement joli ; nous sommes bien servis par l’habillage et par les instruments technologiques qui sont utilisés, notamment les écrans de projection pour le discours de Jacques Létourneau. Je suis très heureuse de ce constat, car selon moi, la CSN a besoin de moderniser ses façons de faire et d’accompagner ses membres dans l’utilisation d’outils technologiques qui vont leur permettre d’alléger certains processus, comme la tenue d’assemblées générales. Ce congrès témoigne de la capacité de la CSN à s’engager dans cette voie, bravo. » « Je trouve que le congrès est bien organisé et que les membres ont une place de choix pour s’exprimer. On a réussi à créer une belle synergie, à comprendre les luttes que mènent les uns et les autres, même si nous ne sommes pas en présence. C’était un défi, et on peut dire que c’est réussi. J’ai aussi bien apprécié la séance d’ateliers qui a donné lieu à des échanges stimulants. Ces discussions nous ont permis de comprendre les différentes réalités des membres sur le terrain. Je me réjouis aussi de constater à nouveau, durant ce congrès, que la CSN fait du projet de loi 59 et des changements qui doivent y être apportés une priorité. Ce projet de loi constitue une véritable attaque pour le secteur de la construction, alors que, faut-il le rappeler, il s’agit du secteur d’activité qui connaît le plus grand taux d’accidents et de décès sur les lieux de travail. Merci la CSN. »
« Je trouve que le congrès est bien organisé et que les membres ont une place de choix pour s’exprimer. On a réussi à créer une belle synergie, à comprendre les luttes que mènent les uns et les autres, même si nous ne sommes pas en présence. C’était un défi, et on peut dire que c’est réussi. J’ai aussi bien apprécié la séance d’ateliers qui a donné lieu à des échanges stimulants. Ces discussions nous ont permis de comprendre les différentes réalités des membres sur le terrain. Je me réjouis aussi de constater à nouveau, durant ce congrès, que la CSN fait du projet de loi 59 et des changements qui doivent y être apportés une priorité. Ce projet de loi constitue une véritable attaque pour le secteur de la construction, alors que, faut-il le rappeler, il s’agit du secteur d’activité qui connaît le plus grand taux d’accidents et de décès sur les lieux de travail. Merci la CSN. » « Je suis impressionné par l’organisation du congrès. J’avoue que j’avais un peu peur, que je m’attendais à pire, mais je suis agréablement surpris. Ça se passe bien, les débats se font et la démocratie est respectée. J’ai trouvé ça particulièrement intéressant d’entendre en atelier les gens parler de la COVID et comment ils ont dû s’adapter, car nous aussi, les agents correctionnels, avons été fortement touchés par le virus. J’ai bien aimé suivre les présentations des candidats et des candidates aux élections, c’était professionnel et pertinent. Évidemment, l’énergie et la chaleur d’un congrès en présence sont absentes. Il y a une différence entre prendre la parole devant 2000 personnes dans une salle de plénière et prendre la parole seul, devant son ordinateur dans sa cuisine… Mais dans l’ensemble, c’est une réussite. »
« Je suis impressionné par l’organisation du congrès. J’avoue que j’avais un peu peur, que je m’attendais à pire, mais je suis agréablement surpris. Ça se passe bien, les débats se font et la démocratie est respectée. J’ai trouvé ça particulièrement intéressant d’entendre en atelier les gens parler de la COVID et comment ils ont dû s’adapter, car nous aussi, les agents correctionnels, avons été fortement touchés par le virus. J’ai bien aimé suivre les présentations des candidats et des candidates aux élections, c’était professionnel et pertinent. Évidemment, l’énergie et la chaleur d’un congrès en présence sont absentes. Il y a une différence entre prendre la parole devant 2000 personnes dans une salle de plénière et prendre la parole seul, devant son ordinateur dans sa cuisine… Mais dans l’ensemble, c’est une réussite. » « Du fait que mon premier congrès se déroule en mode virtuel, je trouve que ça nous coupe du contact humain qui se retrouve fondamentalement au centre de notre action syndicale. Malgré tout, le tout est très intéressant. Le contexte de pandémie actuel et les échanges dans le cadre de l’atelier m’ont grandement motivée à faire de la santé et sécurité du travail une priorité pour 2021. »
« Du fait que mon premier congrès se déroule en mode virtuel, je trouve que ça nous coupe du contact humain qui se retrouve fondamentalement au centre de notre action syndicale. Malgré tout, le tout est très intéressant. Le contexte de pandémie actuel et les échanges dans le cadre de l’atelier m’ont grandement motivée à faire de la santé et sécurité du travail une priorité pour 2021. »