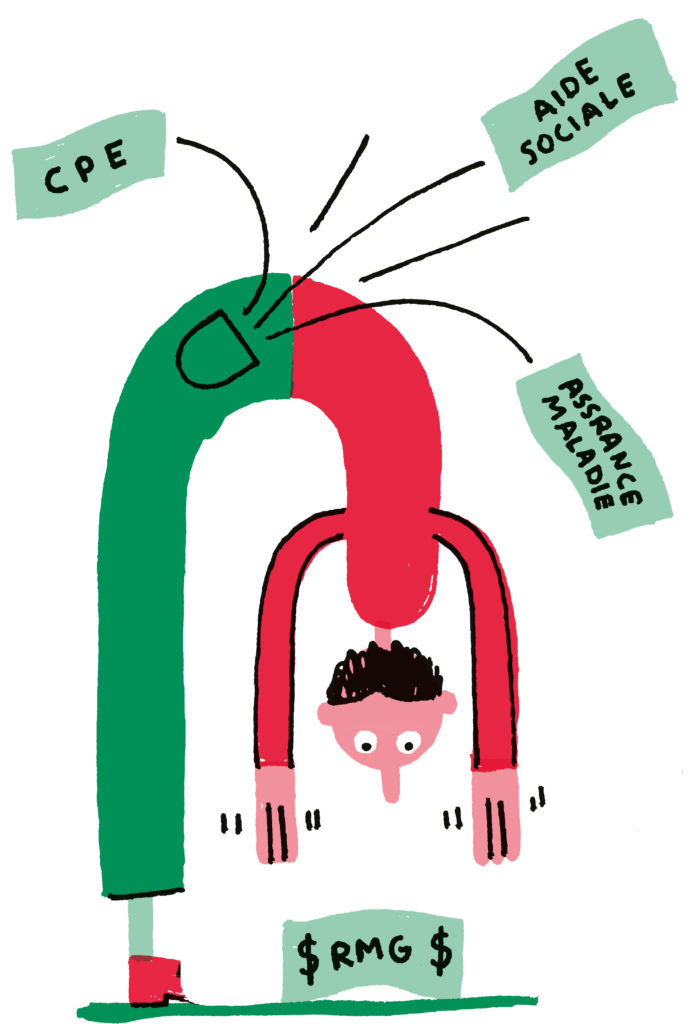Le plus long conflit de travail de l’histoire du Québec, voire du Canada, s’est terminé le 7 mai dernier par une remarquable victoire pour quelque 400 travailleuses et travailleurs qui, grâce à l’appui du mouvement CSN, ont fait reculer leur employeur et fait respecter leurs droits.
Au cours de cette journée historique, les 350 syndiqué-es présents à l’assemblée générale ont voté à 92 % pour l’entente de principe intervenue avec Olymel de Saint-Simon, une usine de découpe de porc située en Montérégie. L’entreprise milliardaire, propriété de la Coop fédérée, a été tenue responsable par les tribunaux d’avoir congédié illégalement 407 salarié-es, en avril 2007. Cette entente, qui totalise 9,4 millions de dollars, n’effacera pourtant jamais les séquelles laissées dans le cœur de ces femmes et de ces hommes en raison d’un profond ressentiment à l’égard de cette entreprise qui a fait perdurer le conflit pendant près de dix années.
Pour Jacques Létourneau, président de la CSN : « Un conflit comme celui d’Olymel est la plus belle démonstration qu’il ne faut jamais lâcher. Les travailleurs ont tenu effectivement la minute de plus. Cette combativité est d’ailleurs un principe fondamental à la CSN. Les gens d’Olymel l’ont prouvé : c’est collectivement que nous sommes plus forts. En se tenant solidairement ensemble, avec l’appui de toutes les composantes de la CSN, ces travailleurs ont été capables de faire reculer cette multinationale québécoise. »
Un règlement en trois volets
L’entente comporte d’abord le versement de 8,2 millions de dollars aux travailleuses et travailleurs pour compenser la perte de revenus engendrée par leur mise à pied prématurée six mois avant la fin de la convention collective, prévue en octobre 2007. Malgré une décision arbitrale émise en 2006 lui ordonnant de maintenir ses activités, Olymel avait outrepassé ses droits.
Outre six mois de salaire, l’entente inclut les intérêts accumulés depuis les mises à pied forcées, conformément à une autre sentence arbitrale statuant que la fermeture de l’usine était illégale. Une décision confirmée par la Cour supérieure et, par la suite, par la Cour d’appel du Québec qui a refusé d’entendre la demande de révision d’Olymel. C’est d’ailleurs à la suite de ces échecs cuisants que l’entreprise s’est décidée à négocier un règlement avec le Syndicat des travailleurs d’Olympia, la Fédération du commerce et la CSN.
Par ailleurs, cette entente a permis de mettre fin au lock-out décrété par Olymel en octobre 2007 pour une vingtaine de travailleurs qui avaient été maintenus en poste après la fermeture illégale. Conséquemment, les parties ont signé une nouvelle convention collective qui permettra à une vingtaine de travailleurs de reprendre le travail à l’automne 2017, dans ce qui deviendra dans les prochains mois un mégacentre de distribution d’Olymel. La nouvelle convention sera en vigueur jusqu’en 2024.
Enfin, un dernier litige vieux de 2003 portant sur le paiement d’heures supplémentaires a aussi été résolu. Les travailleuses et travailleurs avaient alors contesté par voie de grief une pratique de l’employeur consistant à contourner une clause sur les heures supplémentaires par la création d’un quart de travail fictif. Cette portion de l’entente comprend un règlement de 1,2 million de dollars à être versés à environ 600 travailleurs à l’emploi d’Olymel à cette époque.
Michel Daigle, ex-travailleur d’Olymel embauché en 1975 et président du Syndicat des travailleurs d’Olympia de Saint-Simon (CSN), ne cache pas sa satisfaction à l’égard de l’entente : « On a vraiment le sentiment du devoir accompli, dit-il. Cette entente est comme un baume appliqué sur l’affront qu’Olymel nous a fait de ne pas avoir respecté la convention collective et d’avoir imposé un si long lock-out. Grâce à la CSN, on a réussi à obtenir ce règlement-là. La seule chose que je n’oublierai pas, par contre, c’est le fait que ç’a duré trop longtemps. Et je pense surtout aux membres qui n’ont pas pu bénéficier de ce règlement de leur vivant. » Quelque 25 travailleurs sont en effet décédés au cours du conflit, avant la conclusion de cette entente. Ce sont leurs ayants droit qui en bénéficieront.
La voix pleine d’émotion, Pierre Lepage, à l’emploi d’Olymel depuis 1985, résume pour sa part l’état d’esprit qui régnait lors de l’assemblée extraordinaire : « Ça fait dix ans que l’usine est fermée. Il y a encore 300 à 400 personnes ici aujourd’hui. On s’est tous battus pour la même affaire. On a gagné parce qu’on s’est tenus debout. Aujourd’hui, ceux qui sont ici, ce sont ceux qui ont fait face à une multinationale avec un chiffre d’affaires de quatre à sept milliards de dollars. On peut être fiers, on est encore debout !
- 2017 — 407 syndiqué-es CSN congédiés illégalement par Olymel, à Saint-Simon, de même que 25 travailleurs mis en lock-out dix ans plus tôt obtiennent 9,4 millions de dollars en compensations financières.
- 2014 — 130 travailleuses et travailleurs injustement congédiés par le CRDITED de Montréal ont pu, pour la plupart, réintégrer leur emploi, en plus d’obtenir une compensation totalisant près de quatre millions de dollars.
- 2013 — Après de nombreuses démarches, les ex-travailleurs de Celanese de Drummondville ont recouvré une somme de près de 8 millions de dollars que l’employeur avait détournés de leur caisse de retraite lors de la fermeture de l’usine en 2000.
- 2009 — 65 travailleuses et travailleurs du magasin Zellers d’Alma, fermé illégalement en 1995, ont vu leurs droits rétablis après une lutte de près de 15 ans. Une entente comportant d’importantes compensations financières a finalement été conclue hors cour.
- 1999 — Après une longue saga judiciaire, la CSN a obtenu la réintégration de près de 150 travailleurs de Métro-Richelieu congédiés illégalement des années auparavant, en plus d’obtenir des compensations totalisant plus de 25 millions de dollars.