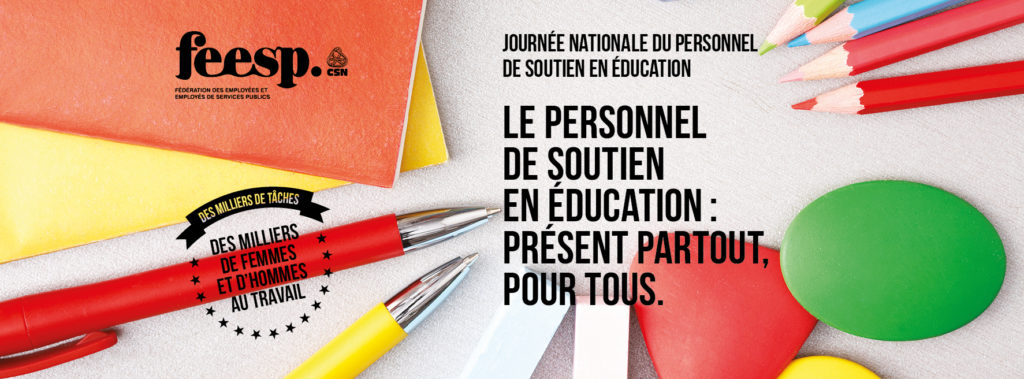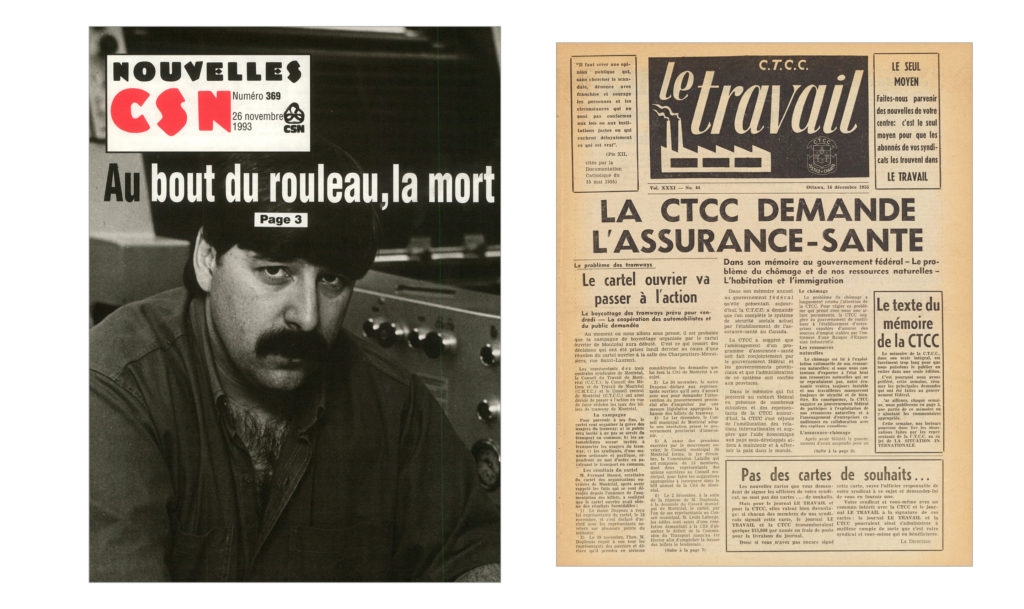À 94 %, les 11 000 travailleuses œuvrant dans plus de 400 centres de la petite enfance (CPE), syndiquées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), ont voté pour un mandat de six jours de grève à être exercé au moment jugé opportun. Elles souhaitent ainsi lancer un message clair au ministère de la Famille et aux associations d’employeurs des centres de la petite enfance (CPE) : elles sont déterminées à refuser les reculs demandés. Elles souhaitent aussi que les pourparlers soient accélérés dans le but de conclure leurs contrats de travail échus depuis 30 mois, soit le 31 mars 2015.
Près d’une trentaine de séances de négociation ont eu lieu depuis le 8 novembre 2016, dont un blitz de cinq jours tenu en mai dernier qui a permis de régler la presque totalité des dispositions dites non pécuniaires. Toutefois, le comité national de négociation des CPE de la CSN constate, que des divergences majeures persistent, notamment sur les salaires, le régime de retraite, les assurances collectives et les disparités régionales. D’autres enjeux font toujours l’objet de négociation tel que le ratio enfants/éducatrice, le temps de planification pédagogique et le droit des travailleuses de participer au conseil d’administration et aux assemblées des CPE.
Hormis la séance du 26 septembre dernier, quatre rencontres sont prévues dans les prochaines semaines. « On espère que ce calendrier va nous permettre d’obtenir un règlement satisfaisant, affirme Louise Labrie, du comité national de négociation des CPE CSN. À défaut, nos membres nous ont clairement dit qu’elles étaient à bout de patience et prêtes à recourir à la grève si nécessaire. Notre objectif, ce n’est évidemment pas de faire la grève, mais bien de conclure une entente pour assurer des conditions de travail adéquates à nos membres, tout en maintenant une qualité de services aux enfants ».
« Les travailleuses ont raison d’être impatientes alors qu’elles continuent jour après jour à subir les impacts des compressions budgétaires de plus de 300 millions de dollars depuis les dernières années, lance Jacques Létourneau, président de la CSN. Ce qu’elles veulent surtout, c’est de se faire respecter par ce gouvernement qui cherche à négocier à la baisse les conditions de travail alors qu’il dispose de marges de manœuvre financières de plus de 4 milliards de dollars engrangés par trois années d’austérité. Il doit saisir la balle au bond. »
Pour Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN), « Ce qui est aussi en jeu ici, c’est le maintien même de la qualité des services aux enfants en CPE. L’histoire l’a amplement démontré : il n’y a pas d’amélioration possible dans les services de garde éducatifs sans qu’il y ait du même coup des conditions de travail adéquates pour permettre aux travailleuses, peu importe leur appellation d’emploi, de se donner à plein au bénéfice des enfants et de leurs parents. C’est d’ailleurs ce qui a permis d’atteindre le haut niveau de qualité du réseau qui fait l’envie partout au Canada et dans le monde. »
Pour soutenir les travailleuses dans leur lutte, la CSN et ses organismes entendent déployer tous les moyens à leur disposition pour que les travailleuses des CPE obtiennent gain de cause, à commencer par l’implication des différents conseils centraux régionaux partout au Québec. « Dans notre région, explique Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN), les travailleuses pourront compter sur notre soutien concret et notre entière disponibilité, et ce, jusqu’à la toute dernière minute. L’acquis pour la société des CPE est trop important pour baisser les bras et laisser tomber. Ces personnes méritent d’être reconnues, d’être soutenues et d’être respectées. Il est hors de question d’accepter des reculs parce que ce sont des femmes », conclut-elle.
À propos des CPE et de la CSN
Environ 11 000 travailleuses syndiquées réparties dans quelque 400 CPE sont regroupés dans 37 syndicats affiliés à la FSSS–CSN, qui en fait le plus grand regroupement au Québec. La CSN est aussi composée de treize conseils centraux qui regroupent sur une base régionale l’ensemble des syndiqué-es membres de la CSN, dont le CCQCA–CSN qui compte environ 45 000 membres. Pour sa part, la CSN regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations.